Je fête aujourd’hui un bel anniversaire, celui de ma liberté professionnelle ! Voilà 3 ans que j’ai quitté le salariat et je savoure chaque jour un peu plus le goût de cette liberté nouvelle. Non pas la liberté de ne plus travailler mais la liberté de choisir ma route, mon histoire professionnelle. La liberté d’explorer de nouveaux horizons, de me tromper, de bifurquer et d’incarner pleinement ma contribution à l’œuvre que j’ai choisi d’accomplir.
Car c’est bien d’accomplissement dont il est question. Ça n’est pas la liberté que je suis allée chercher en premier lieu en quittant mon emploi de salariée ; c’est la nécessité de combler un désir d’accomplissement personnel dans ma vie professionnelle. Un désir d’expansion, de dépassement de soi littéralement ! La valeur « liberté » ne m’est apparue que récemment, comme la seule voie possible face à une crise que j’ai dû traverser.
« La liberté ne se définit pas par la quantité de choix, mais elle se construit à partir des obstacles qu'elle trouve sur son chemin... » souligne la philosophe Gabrielle Halpern.
La liberté n’est donc pas un acte posé là, une décision que l’on prend. Elle commence par s’insinuer dans notre vie, subtilement, dans les interstices de notre Désir de travail. Elle profite de l’espace que nous lui accordons pour s’y introduire et lorsque ce Désir de travail est bien clair, notre liberté peut s’exprimer pleinement.
Quand on cherche à comprendre en quoi consiste la liberté dans le travail, il est utile de commencer à se questionner sur son Désir de travail. Cette notion a été développée par Roland Guinchard, psychologue et psychanalyste et Gilles Arnaud, psychosociologue et professeur de psychologie des organisations à l'ESCP, dans leur ouvrage Psychanalyse du lien au travail. Le désir de travail. [A lire aussi : « Savoir donner toute sa place à notre désir, dans le travail… »]
Pour les deux auteurs, la question du Désir de travail se pose à tous car il existe chez tout être humain une énergie pulsionnelle orientée vers l’action et la réalisation :
« Cette poussée énergétique brute, en s’intégrant à la psychologie de l’individu au cours des premières années de sa vie, se transforme alors en un désir d’agir et de faire à la recherche d’un accomplissement en ce monde… »
Dans leur ouvrage, ils proposent de changer de regard : plutôt que de chercher à mettre un peu de désir dans le travail, faire apparaître que le travail est partie intégrante du désir humain…
Toute personne qui travaille ou souhaite travailler, doit donc s’attacher à ne jamais renoncer à son désir et s’engager à faire absolument quelque-chose de ce désir-là ! Pas seulement une petite place, ni n’importe quelle place car le désir de travail est exigeant. Chacun d’entre nous a donc la responsabilité de clarifier son Désir de travail pour lui donner toute sa place.
Alors que je m’efforçais en vain depuis des années de donner un nouveau souffle à ma carrière dans la communication, j’ai dû me rendre à l’évidence que mon Désir de travail était ailleurs… Il m’a fallu traverser de nombreux écueils pour, à chaque fois, être amenée à creuser un peu plus profondément en moi et trouver enfin la source de mon Désir de travail. Alors, le temps est venu d’en parler, à toutes les personnes susceptibles de m’aider à le préciser encore et encore, à le comprendre, à le rendre tangible, accessible… jusqu’à me sentir complètement au clair et alignée avec ce Désir de travail.
C’est à ce moment-là que les premiers indices de liberté sont apparus. A travers le sentiment que tout devenait possible grâce à la nouvelle activité que j’étais en train de me construire, au gré de rencontres et d’opportunités. [A lire aussi : « Quand tout devient possible ! »]
Assez naturellement, est né ensuite le besoin de nourrir ce désir de travail en s’aventurant dans de nouvelles contrées pour continuer à apprendre et ainsi, me dépasser. Car, selon Spinoza, le désir est un effort pour persévérer dans son être. Cette période où l’on explore le champ des possibles, où l'on se « jette à l’eau » pour apprendre encore et challenger ses capacités, est d’une richesse incroyable ! On repousse les limites toujours plus loin pour s’augmenter et tendre vers la liberté. Pour le penseur indien Jiddu Krichnamurti, apprendre est un mouvement qui libère l’esprit et qui ouvre en grand l’espace dans lequel notre Désir de travail peut s’exprimer.
Selon Jiddu Krichnamurti, la liberté intérieure est impossible sans cet espace intérieur.
« La liberté est un état d’esprit. Un état d’esprit qui ne peut être compris sans l’espace. La liberté exige de l’espace. L’esprit ne peut-il jamais être libre s’il ne possède pas à l’intérieur de lui-même un espace illimité ? »
A ce moment-là, après que j’ai créé l’espace permettant à mon Désir de travail de s’épanouir, j’ai pris conscience combien la valeur liberté était devenue cruciale pour moi.
Si l'on s’inspire de la conception énergétique du désir de Spinoza, faire toute sa place au Désir de travail revient à déployer une puissante énergie au service d’une mission qui nous tient à cœur.
L’enjeu pour l’entreprise et le management se situe dans leur capacité à donner aux personnes qui travaillent la liberté d’agir, de créer et de s’accomplir autant que possible dans leur activité professionnelle. Pour cela, il convient de prendre en compte la singularité de chaque individu et de reconnaître l’énergie humaine qui est à l’œuvre dans son travail. [A lire aussi : « Trouver sa juste place au travail, c’est permettre à sa singularité de s’exprimer pleinement »]
Récemment, Marie, une jeune manager que j’accompagne me partageait son intention de faire monter en compétence son équipe pour que chaque individu gagne en autonomie et prenne ses responsabilités dans ses missions. Et là, perplexe, elle constatait qu'en réaction, la plupart des membres de son équipe s’étaient mis en retrait de leurs responsabilités. Pour bien comprendre, il faut savoir que cette équipe a longtemps travaillé « sous cloche », dirigée par un manager omniprésent qui commandait la moindre tâche à effectuer. Cette liberté subitement offerte par leur nouvelle manager est apparue très effrayante pour une équipe qui a longtemps été maternée.
Pour permettre à ses collaborateurs de prendre la mesure de leurs responsabilités, Marie, doit donc veiller à faire émerger le Désir de travail de chacun des membres de son équipe. Inscrire ces désirs individuels dans une ambition commune et une exigence forte invitant au dépassement. Et rendre visible par la reconnaissance le chemin parcouru et le fruit des efforts consentis par chacun.
« Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité » Victor Hugo
Dans son ouvrage Travail, la soif de liberté, le DG de la Word Employment Confederation, Dennis Pennel milite pour un modèle plus organique d’entreprise, qui passe par une meilleure reconnaissance et un meilleur respect de la nature humaine, où l’être humain est considéré d’abord pour ce qu’il apporte plus que pour ce qu’il exécute.
Il pointe la naissance d’un nouvel âge du travail, réconcilié avec la liberté, pour répondre à une aspiration profonde des travailleurs vers plus d’autonomie et moins d’autorité. Il dépeint dans son livre le « besoin d’air » qu’éprouvent nombre de salariés face à des prescriptions de plus en plus contraignantes et une charge de travail de plus en plus stressante.
Denis Pennel accuse la « perte de soi-même » car beaucoup de travailleurs n'ont le sentiment d’être eux-mêmes qu’en dehors du travail ; dans le travail, ils se sentent en dehors d’eux-mêmes.
Denis Pennel nous invite à introduire une forme d’écologie humaine au travail : « tout comme l’écologie de la nature doit entendre le cri de la planète, celle du travail doit écouter le cri de hommes ! »
Le travail a connu de nombreux bouleversements ces dernières années. Tout d’abord avec le déploiement du télétravail, le travail est de moins en moins un endroit où se rendre qu'une activité à mener. Dans le même temps, les heures de bureau ont volé en éclat ! Autre phénomène observé par Josh Bersin, analyste pour Deloitte : « Dans le monde d’aujourd’hui, les gens ne sont plus embauchés pour un poste mais plus pour des rôles qu’ils vont occuper. Ils sont responsables de « missions » et de « projets » et plus simplement d’une fonction ».
Pour autant, même si aujourd’hui le travail s’est affranchi de l’espace, du temps, de la fonction, il étouffe encore dans un cadre trop rigide et coercitif conçu à l’ère industrielle, qu’est le modèle du salariat. Selon Denis Pennel, le salariat est devenu un choix par défaut, non pour ses caractéristiques intrinsèques mais plutôt pour la protection et la couverture sociale que son statut garantit. Il prône l’émergence d’un nouveau modèle, inspiré de la révolution du travail portée par les start-uppers, slaschers, co-workers : le « libertariat ».
Denis Pennel décrit le « libertariat » comme : « la recherche d’un marché du travail sans domination et sans exploitation, où les individus s’associent et coopèrent librement dans une dynamique de liberté et de respect mutuel tout en bénéficiant d’une protection juridique et sociale garantissant leurs droits fondamentaux ».
Selon l’auteur, nous ne règlerons pas les problèmes du XXIe siècle par des solutions inventées au XXe. Il invite plutôt à regarder du côté de ceux qui cherchent de nouvelles solutions permettant aux individus de redevenir acteurs et sujets de leur travail et d’accomplir une activité qui leur tient à cœur.
Il cite une interview du philosophe Bernard Stiegler en 2015 : « La société de demain devra tirer de chacun de nous le meilleur aussi souvent que possible. Or ce meilleur, c’est ce que nous faisons de bonne volonté. Lorsque je suis libre de mon temps et que je m’adonne à ce que j’aime, je donne le meilleur de moi-même ».
A l’heure où les robots libèrent l’homme du travail le plus pénible, pour Denis Pennel, il est essentiel de se recentrer sur l’humanité au travail, sur ce que seul l’homme peut accomplir face aux robots. Après les bras et le cerveau, c’est maintenant au cœur de prendre le dessus dans le travail.
Il nous partage l’extrait d’une interview du consultant américain Dov Seidman dans Les Echos : « nous sommes passés d’une économie industrielle – où on embauchait des bras – à une économie de la connaissance – où on embauchait des têtes – et maintenant une économie humaine – où on embauche des cœurs ».
Dans cette révolution du travail en marche, l'émergence des cœurs risque fort de chambouler les mécanismes de l’entreprise et la société toute entière. Pour ma part, je compte bien y contribuer, à mon échelle !
Mes sources d'inspiration Psychanalyse du lien au travail. Le désir de travail de Roland GUINCHARD Travail, la soif de liberté de Denis PENNEL LES ECHOS - Quand les entreprises embaucheront des cœurs
A l’approche des élections présidentielles, avec la multiplication des débats entre candidats et autres interviews dans les médias, me voilà de nouveau en proie à mes vieux démons… Ces combats de mots, ces attaques qui fusent, ces allégations mensongères dont le seul objectif est de faire poser genou à terre à son adversaire, tout cela m’oppresse !
Au lendemain d’un débat très commenté entre deux candidats, j’écoutais un programme à la radio dédié au décryptage de ce qui fût, selon certains chroniqueurs : « un duel et même un combat de catch plutôt qu’un échange, entre deux adversaires qui s’interrompaient et se hurlaient dessus sans s’écouter ». Et là, incroyable, l’émission de radio a pris la tournure d’un débat dans le débat, entre une partie des journalistes considérant qu’il n’y avait pas de débat sans surjouer, sortir les poings et s’invectiver, et les autres pour qui de telles foires d’empoigne finissaient par stériliser le débat, annihiler les idées et au bout du compte contribuaient à perdre les électeurs…
Effectivement, étymologiquement, le mot débattre signifie battre, frapper, rosser avec intensité. Et sans subtilité, ni nuance aucune, c’est bien ce à quoi se prêtent nombre de nos édiles politiques, encore aujourd’hui, et de façon de plus en plus virulente, me semble-t-il.
« Si bien que le débat politique finit par s’apparenter à ces reconstitutions de joutes chevaleresques, où des cascadeurs se livrent à une démonstration d’escrime chorégraphiée en poussant de grands cris rageurs, tout en sachant qu’ils ne courent aucun danger parce que leurs épées sont émoussées. Et pendant que nous nous divertissons devant ces simulacres d’affrontements herculéens, sans cesse rejoués, il y a une chose qu’hélas, nous perdons de vue : le véritable débat d’idée. » comme le souligne Clément Viktorovitch, journaliste à France Info dans son émission Entre les lignes en décembre 2021.
Et si nous nous employions à « relever le débat » ? Façonner une parole noble, forte et utile pour donner à comprendre et faire avancer les idées. Faire preuve d’exemplarité dans notre langage en s’inspirant de virtuoses de l’art oratoire, de champions de l’éloquence, d’amoureux de la parole, qui la portent avec talent dans les prétoires… Dans cet article, je m’inspire de deux ouvrages : Remarques sur la parole de Jacques Charpentier, Bâtonnier du barreau de Paris de 1938 à 1945 et La parole est un sport de combat de Bertrand Périer, avocat et enseignant de l’art oratoire à Sciences Po et HEC.
Alors que J. Charpentier s’amuse à opposer écriture et art oratoire, il est frappant de voir combien ses écrits sont porteurs de sa parole vibrante. Lui qui enseigne que la parole est d’abord un corps en mouvement et une tension. Il nous donne à lire ici un verbe vivant, vigoureux et volontaire.
En 1961, date de la parution de son ouvrage, J. Charpentier se questionnait sur l’avenir de la parole : « En l’an 2000, les hommes parleront ils encore ? ». Il percevait alors que la parole était en voie de régression. Pour lui, l’art oratoire était déjà gagné par la maladie : « Nous ne sommes pas en présence d’un accident, mais d’une affection déjà ancienne et qui a grandi. D’abord un léger voile sur les notes hautes, un peu de laryngite. Une extinction de voix. Puis l’enroulement est devenu chronique. Et un jour, le cancer se généralise ».
J. Charpentier avait également une vision très éclairée de la déliquescence de la parole politique. Il était pour lui évident que l’éloquence politique était en chute verticale. Il constatait depuis un demi-siècle la suppression progressive du débat public. Un constat qui l’amenait à porter un regard très dur et pourtant lucide sur l’impact de cette déliquescence sur la société.
« Dans un monde qui ne s’intéresse qu’à la quantité, les combats de l’esprit ne seront plus que des batailles de chiffres. A tout propos on nous ferme la bouche avec des statistiques. Mais pour rendre les équations accessibles aux foules, on les remplacera par des graphiques, des courbes, des feuilles de température, ou des images violentes qui se graveront dans les mémoires. »
Pour être transparente avec vous, j’avais prévu de donner comme sous-titre à ce chapitre : « Le contre-exemple du débat politique d’aujourd’hui » ! J’ai finalement décidé de l’aborder sous un angle plus positif… Alors pour éviter de biaiser mon analyse, étant donné que les débats politiques actuels m’angoissent littéralement, je préfère vous partager quelques extraits du décryptage du politologue et maître de conférences à Paris II, Benjamin Morel, dont vous trouverez l’intégralité de la chronique dans les ressources en toute fin du présent article.
Il s’agit ici d’entrevoir la portée possible d’un débat politique en partant d’un cas concret, significatif de ce que la campagne présidentielle nous donne à voir. J’ai choisi cet exemple indépendamment de l’identité et du bord politique des candidats qui sont les protagonistes de ce débat. L’objectif consistant simplement à en analyser la forme au regard des enjeux électoraux.
Pour B. Morel, chacun des deux candidats, en perte de vitesse dans les sondages, a cherché à se démarquer de son adversaire en incarnant une posture opposée, en surjouant ses positions pour construire l’autre candidat comme le négatif de lui-même.
Ces postures très tranchées, voire agressives, ont donné lieu à des échanges extrêmement vifs incitant les journalistes à intervenir à plusieurs reprises pour demander aux débatteurs d’arrêter de s’apostropher. Le débat a rapidement tourné à la cacophonie avec des interruptions multiples qui ont pu avoir comme conséquence de dé-présidentialiser chacun des candidats.
Dans ce face à face, on voit clairement que la stratégie de décrédibilisation de l’adversaire adoptée par chacun des candidats, non pas sur le fond des idées mais sur la personne, a conduit à ce qu’ils se neutralisent mutuellement. D’une certaine manière, les rhétoriques qui s’affrontent conduisent à stériliser les échanges. Au bout du compte, cela perd les électeurs et pour les deux candidats, le débat est une occasion manquée.
Voilà un exemple type du discours politique comme instrument de conquête du pouvoir, tel que le dépeint B. Périer. Nous atteignons ici des extrémités qui rendent inaudible toute vision politique, à part peut-être pour les plus avertis. Comment réconcilier les citoyens avec la politique en se donnant en spectacle dans un théâtre de stratégies et de manipulations ? Pour sa part, J. Charpentier considère que toutes les maladies du langage sont des défaillances de la volonté !
Pour toucher une population, un débat ne doit-il pas rentrer dans la société ? Se plonger dans les questions du quotidien ? Aborder avec humilité les crises traversées ? Ecouter avec compassion les besoins exprimés. Explorer avec curiosité les initiatives qui fonctionnent à une petite échelle pour les diffuser à des échelles plus grandes… Porter une parole ancrée dans le réel et dans l’humain, comme l’évoque B. Périer.
J. Charpentier considère qu’il n’y a que deux manières d’apprendre à parler : Parler. Ecouter : « le premier devoir de l’orateur est de connaître – ou de deviner – la vérité de ceux qui l’écoutent. Pour que ses vérités à lui s’incorporent à eux, qu’elles deviennent leur sang et leurs muscles… ».
Telle est l’invitation de B. Périer. Pour lui, le vrai débat d’idées est une façon d’éviter les rapports de force car la violence naît de l’incapacité à confronter les points de vue et à se comprendre...
« L’écoute, plutôt que les coups. Débattre, plutôt que se battre. […] En aidant chacun à exprimer sa pensée de façon plus exacte, plus précise, plus argumentée, en bannissant les invectives et les propos rudimentaires, j’ai la conviction que l’on facilite le débat, et que l’on parvient à faire reculer les violences qui naissent de l’incompréhension. De la même façon que la parole peut diviser, elle doit aussi pouvoir nous réunir. Pas nécessairement dans le consensus mais dans le goût partagé de la controverse. »
La parole est nécessaire à la construction de liens sociaux car elle favorise la communication pour nous amener vers une compréhension mutuelle. La parole permet ainsi d’élaborer un monde commun ; elle s’inscrit dans une relation à travers laquelle chacun peut exprimer des pensées, des émotions, des valeurs, des besoins… et partager des informations, des connaissances, des intentions… En cela, la parole est un mode d’accomplissement privilégié qui nous fait exister pour soi et à travers les autres. [A lire aussi : « Cultiver son langage, c’est prendre soin de soi et des autres… »]
Pour la politologue, philosophe et journaliste Hannah Arendt, « c’est parce qu’ils peuvent parler ensemble sur ce qui les concerne tous que les hommes peuvent partager la même vie et le même monde. Le dialogue est pour elle bien plus qu’une condition de la vie en société, il est un critère majeur d’humanité ».
Parce que la voix humaine est contagieuse, pour J. Charpentier, c’est grâce à la parole que nous pouvons passer à l’action. Pour lui, la parole est action ou n’est rien. Parler, c’est faire du travail. On juge la parole à ses résultats. C’est en passant l’épreuve d’un débat qu’une idée, une théorie révélera sa force ou sa faiblesse et qu’elle mènera ou non à l’action.
Parler, ce n’est pas rien dès lors que l’on met une intention dans le langage ou que l’on partage des intentions mutuelles dans la cadre d’un dialogue. Dans la discussion, parler consiste à chercher la compréhension mutuelle, rendre explicite l’implicite, c’est une réelle entreprise coopérative.
Le pouvoir du langage c’est celui de nommer, de créer et donc de réaliser une réalité. Alors, la parole devient action dans le sens où elle vise à accomplir quelque chose. Et le vouloir dire entraîne le pouvoir agir. Tout l’enjeu est ici d’inventer des espaces pour favoriser cette parole dans laquelle on se comprend et à travers laquelle on décide de se mettre en action.
« Parler, c’est convertir. Au moins convaincre ; ou raffermir des convictions chancelantes ; ou rapprocher des divergences ; ou mettre au monde des opinions embryonnaires ; au moins répandre un sentiment, propager une disposition, jeter la graine au vent, lancer la bouteille à la mer. » clame J. Charpentier.
Dans la même veine, B. Périer convoque une parole qui part à la recherche de ce qui nous rapproche plutôt que de ce qui nous sépare. Cela suppose de se positionner honnêtement et de ne pas caricaturer la pensée de l’autre dans le débat d’idée.
Dans ce chapitre, je vous propose d’étudier trois « espaces », à inventer ou existants, pour apprendre à discuter, débattre, délibérer et surtout, pour se comprendre et faire avancer les idées. Il m’a semblé intéressant d’appréhender trois dispositifs proches dans leur philosophie et complémentaires dans les populations qu’ils adressent : la société, le monde du travail et la famille. Ces systèmes vertueux venant se soutenir les uns les autres.
Pour François Taddei, spécialiste de l’évolution de la coopération qu’il étudie à l’Inserm, et fondateur du CRI devenu Learning Planet Institute, la démocratie du XXIème siècle, si elle veut survivre et se développer, doit devenir participative à tous les niveaux, du plus local au plus global. Il propose de « déployer, à toutes les échelles, des espaces de délibération démocratique qui intégreraient dans leur structure et leur fonctionnement les piliers d’une décision éclairée : la recherche de la compréhension des faits (par la science), la formation permanente des acteurs et l’écoute des oppositions et contre-pouvoirs ».
F. Taddei imagine une démocratie fondée sur un gouvernement humble qui sait qu’il n’a pas toutes les solutions et qu’il va falloir écouter les citoyens pour coconstruire ensemble un avenir souhaitable. Une démocratie capable d’empathie, de compassion, capable d’entendre les besoins, les désirs et les peurs aussi, dans un processus ouvert et pas descendant. Pour éprouver des solutions qui satisfassent tout le monde. Il propose d’inventer de nouveaux systèmes dans lesquels nous sommes encouragés à faire émerger le meilleur de nous-même, en réintroduisant des débats de qualité et en régulant ceux qui manipulent nos émotions. Il rêve de lieux dans lesquels la culture, l’éducation, l’information de qualité et l'inspiration vont pouvoir émerger.
Un rêve qui fait écho à une invitation de J. Charpentier : « Ecouter. Chaque fois que l’occasion s’en présente. Fréquenter les églises, les palais de Justice, les universités, les Parlements. Ecouter les maîtres. Ecouter les médiocres, ne serait-ce que pour apprendre d’eux ce qu’il ne faut pas dire. Et tout en écoutant, étudier le public ».
Un autre défi est d’ouvrir le dialogue dans les organisations ! Un dialogue permanent et à tous les niveaux qui s’inscrit dans les routines de l’entreprise de manière à élaborer ensemble les bases de l’action collective.
Là encore, le dialogue dans le travail s’articule autour de deux dimensions fondamentales : l’écoute et la discussion, pour confronter les objectifs stratégiques avec les réalités opérationnelles. L’enjeu est d’ouvrir le débat au sein des équipes sur les différentes façons d’envisager l’activité et partager sur les critères du travail bien fait. En somme, créer des lieux d’expression sur l’activité dédiés à la coopération, permettant à chacun de développer son pouvoir d’agir dans une optique de résolution de problèmes. [A lire aussi : « Communiquer sur le travail, c’est bien… Communiquer dans le travail, c’est mieux ! »]
Pour coopérer, selon le sociologue Philippe Zarifian : « il faut partager la compréhension des problèmes, confronter leur analyse, se projeter ensemble dans l’avenir et anticiper les actions à mener, voire coélaborer, coécrire en quelque sorte la conception de ce que l’on doit entreprendre ensemble ».
Ces espaces au sein desquels les personnes qui travaillent peuvent faire entendre leur voix pour que les modalités de l’action commune soient mises en délibération sont les Espaces de Discussion sur le Travail, développés par l’ANACT. Cette pratique permet une discussion centrée sur l’expérience du travail et ses enjeux, les règles de métier, le sens de l’activité, les ressources, les contraintes… C’est un lieu essentiel de progrès et d’innovation, car vecteur d’apprentissages individuels et collectifs, au croisement de la performance sociale et économique.
Dans son ouvrage L’entreprise délibérée. Refonder le management par le dialogue, Mathieu Detchessahar, professeur des Universités - Laboratoire d'Economie et de Management Nantes-Atlantique (LEMNA), l'assure : « Quand il est vécu à un bon niveau de dialogue, le travail devient une véritable « école de la citoyenneté » où l’on s’entraîne à examiner des problèmes de façon partagée et critique, où l’on est invité à cultiver les vertus de la dépendance assumée : écoute, prudence, maîtrise de soi, respect d’autrui… ».
L’entreprise n’est pas en dehors de la société, elle est la société ! C’est pourquoi elle a un rôle déterminant à jouer dans l’organisation de la vie au travail. Constituée de femmes et d’hommes animés par des aspirations sociales renouvelées et portés par un élan de vivre ensemble inégalé, l’entreprise est responsable de la qualité du lien social qui s’y inscrit.
La famille est le premier système au sein duquel les jeunes enfants commencent à acquérir les compétences sociales fondamentales qui vont forger leur vie d'adulte. Pour acculturer les plus jeunes à l’art de la discussion et du débat au sein du foyer, j’ai pour ma part expérimenté les Temps d’Echange en Famille (TEF), un outil de discipline positive aux nombreuses vertus. Ces rendez-vous hebdomadaires d'une trentaine de minutes permettent aux membres de la famille d’apprendre à s’apprécier de façon positive en se remerciant et en se faisant des compliments. Un autre objectif consiste à s’aider les uns les autres, à résoudre des problèmes et trouver des solutions sur des préoccupations qui adressent parents comme enfants. Et enfin, bénéfice non négligeable de ces rencontres, elles contribuent à se faire plaisir ensemble et à planifier des activités en famille.
Mes enfants, aujourd’hui jeunes adultes, se souviennent encore de nos Temps d’Echange en Famille qui ont rythmé leurs fins de week-end pendants de nombreux mois. Je me rappelle encore de la joie que j’ai éprouvée à les voir exprimer de plus en plus facilement des manifestations de reconnaissance mutuelle et à trouver des solutions par eux-mêmes à leurs petits tracas du quotidien. Ce type d'espace est parfaitement adapté pour favoriser l'apprentissage de l'empathie et de la conversation à l'école également.
EtSiNous apprenions à fusionner nos horizons à la recherche d’une vérité partagée dans le dialogue, en société, au travail, en famille ?
EtSiNous inventions des espaces pour discuter, débattre, délibérer et faire avancer les idées, avec des chercheurs, des philosophes, des sociologues, des journalistes, des amoureux du langages et tous ceux qui se retrouvent dans ce rêve éveillé…
Quelques références pour poursuivre l'inspiration : FIGARO LIVE - Débat Pécresse/Zemmour : notre débrief FRANCE INFO - Entre les lignes - Quand le débat politique devient une joute chorégraphiée FRANCE CULTURE - Les Chemins de la philosophie - Parler, est-ce agir ? FRANCE CULTURE - L'invité(e) des matins du samedi - François Taddei : "La coopération est l'avenir de notre société" THE CONVERSATION - Portrait(s) de France(s) : où en est le débat public ? SISMIQUE Podcast - David COLON : Nos cerveaux sous contrôle
J’aimerais apporter un éclairage sur une capacité vitale pour tout individu dans sa vie personnelle comme dans sa vie professionnelle : la confiance. La confiance peut tout changer, selon si vous la ressentez ou pas… Elle est, selon moi, un véritable marqueur de notre société. Car la confiance est au cœur des besoins exprimés aujourd’hui, individuellement et collectivement, pour réduire l’incertitude dans notre société et donc le sentiment de risque, et ainsi, permettre à chacun de se projeter sereinement vers un futur qu’il envisage comme possible.
La confiance a pris une dimension toute particulière dès les premières semaines de la crise sanitaire. Dans les entreprises, elle s’est trouvée exacerbée par la nécessité pour les dirigeants et les managers de déployer le travail à distance en responsabilité, en limitant les moyens de contrôle. Dans la société toute entière, elle s’est vue questionnée au regard des nombreuses inconnues qui ont jalonné l’évolution de la pandémie et des décisions prises par le gouvernement pour tenter d’en limiter les effets sur la population. Force est de constater que la confiance ne va pas de soi… Elle n’est pas quelque chose que nous devons considérer comme acquis une fois pour toutes. C’est une œuvre que nous devons consolider, chérir et préserver soigneusement. La confiance est un choix !
Dans le contexte des élections présidentielles, nous voyons chaque jours les dégâts causés par les postures de méfiance, voire de défiance, développées par certaines personnalités politiques, car elles génèrent une véritable crise de confiance vis-à-vis de nos institutions et de la société dans son ensemble. Un fléau que nous avons la responsabilité d’enrayer tant il nous entraîne dans un engrenage délétère et nous enferme dans une vie étriquée, cynique et insatisfaisante. Nous devons prendre conscience que chercher à obtenir des résultats en détruisant la confiance est une stratégie court-termiste car elle s’avère insoutenable dans le temps…
« La confiance est partie intégrante de la trame de notre société. Nous comptons sur elle. Nous la tenons pour acquise jusqu’au moment où elle est altérée ou détruite. Nous réalisons alors, dure prise de conscience, que la confiance est sans doute aussi vitale pour nous que l’est l’eau pour un poisson. Sans confiance, une société se désintègre et finit par imploser. » Stephen M.R. Covey
Fort heureusement, comme toute capacité humaine, la confiance se cultive. Il est à la portée de tout un chacun d’apprendre comment établir, accorder et restaurer la confiance autour de soi. Une « confiance intelligente », synonyme de discernement, moteur de l’action et catalyseur de la relation !
Dans son ouvrage « Le pouvoir de la confiance, l’ingrédient essentiel de l’épanouissement et de la performance », Stephen M.R. Covey, l’homme d’affaires et conférencier américain évoque une « économie de la confiance » à travers une formule simple qui fait de la confiance une variable tangible et quantifiable. Sa formule est basée sur une idée décisive : la confiance affecte toujours deux facteurs, la vitesse et le coût. Quand la confiance baisse, la vitesse baisse aussi et le coût augmente. Quand la confiance augmente, la vitesse augmente aussi et les coûts décroissent.
« L’impact pratique très tangible de l’économie de la confiance se mesure dans beaucoup de relations, dans beaucoup d’interactions, où nous payons un impôt masqué de basse confiance sans même nous en apercevoir ! »
Selon Stephen M.R. Covey, cet impôt basse confiance ne se limite pas à l’activité économique. Il est perceptible dans tous les secteurs, dans toutes les relations, interactions, communications, dans chacune de nos décisions, bref dans tous les aspects de la vie. Dans une entreprise, une confiance élevée améliore la communication, la collaboration, l’exécution, l’innovation, la stratégie, l’engagement, les partenariats et les relations avec toutes les parties prenantes. Dans notre vie personnelle, une confiance élevée améliore nettement notre enthousiasme, notre énergie, notre passion, notre créativité et la joie dans nos relations avec la famille, les amis et la communauté. De toute évidence, les dividendes de la confiance ne se limitent pas à une augmentation de la vitesse et de la rentabilité ; ils se retrouvent dans une satisfaction accrue et une meilleure qualité de vie.
Ce livre vous donne une paire de « lunettes pour la confiance » car pour la plupart des gens, la confiance est une variable invisible. Ils n’ont pas conscience de son impact dans nos relations et notre épanouissement. Mais une fois qu’ils ont chaussé les « lunettes de la confiance », ils détiennent la clé qui va améliorer aussitôt leur efficacité dans tous les domaines.
La confiance est une forme supérieure de motivation et d’inspiration. Rien n’est aussi puissant que l’influence de la confiance quand elle se propage.
Nous avons tous été soumis un jour ou l’autre à des situations de manque de confiance : contrôle tatillon, jugement, rétention d’informations, suspicion… Et nous avons pu éprouver les effets négatifs de ces comportements sur notre engagement, notre enthousiasme, notre créativité et sur le déploiement de notre énergie. A l’inverse, dans des situations où la confiance nous a généreusement été accordée, nous avons pu nous montrer inspirés, libérant le meilleur de nous-même.
Pour créer un environnement de confiance optimal, dans votre famille comme dans votre cadre professionnel, il est bien sûr nécessaire d’être digne de confiance et de savoir construire des relations confiantes à tous les niveaux. Mais c’est votre capacité à « faire confiance » qui est le facteur décisif.
Pour Stephen M.R. Covey : « Accorder sa confiance aux autres régénère l’élan intérieur, aussi bien le leur que le nôtre. Cet acte touche et éclaire la propension innée que nous avons tous à faire confiance et à nous montrer dignes de confiance. La confiance apporte le bonheur dans les relations, les résultats dans le travail et la foi dans la vie. »
Pour apprendre à placer judicieusement sa confiance et développer une « confiance intelligente », deux qualités sont nécessaires : une propension à la confiance et une capacité d’analyse.
Une faculté d’analyse élevée alliée à une forte propension à faire confiance permettent de développer l’intuition nécessaire à un jugement lucide et sage. Cette capacité à la « confiance intelligente » est littéralement effervescente ! Elle stimule une dynamique qui fait émerger sans cesse de nouvelles possibilités.
A l’image d’une onde circulaire à la surface de l’eau, qui se propage de l’intérieur vers l’extérieur par vibrations, la confiance est une force qui se déploie en nous selon cinq vagues. Elle commence au niveau individuel, se propage à nos relations, s’étend à notre cadre professionnel, aux relations professionnelles hors entreprise et jusque dans nos relations sociales en général. La confiance reflète cette approche de « l’intérieur vers l’extérieur » : pour construire la confiance avec les autres, nous devons commencer par nous-mêmes.
1ère vague : la confiance en soi
Le principe de crédibilité
La première vague concerne la confiance que nous avons en nous-même – dans notre aptitude à nous fixer et à atteindre des objectifs, à tenir des engagements, à mettre en accord nos paroles et nos actes – ainsi que la confiance dans notre capacité à inspirer confiance aux autres. L’idée est de devenir pour nous-même comme pour autrui une personne digne de confiance.
La confiance en soi repose entièrement sur la crédibilité, de la racine latine credere, « croire », c’est-à-dire sur votre capacité à développer 4 fondements qui vous rendent crédible à vos propres yeux comme aux yeux des autres :
2ème vague : la confiance relationnelle
L’importance de l’attitude
La confiance relationnelle est centrée de A à Z sur l’attitude… la cohérence de votre comportement. Le principe-clé qui sous-tend cette vague est un comportement cohérent, à savoir la maîtrise du langage et des attitudes adaptées pour instaurer et développer la confiance.
Comme je l’ai évoqué dans mon article [ Cultiver son langage, c’est prendre soin de soi et des autres… Pour tisser des liens sincères et durables ] Parler le langage de la confiance, c’est construire une éthique du dialogue ; un dialogue fondé sur le respect et la dignité de chacun. C’est aussi concevoir le langage comme un agent de liaison, d’échange et d’intégration plutôt qu’un facteur de division. Cette éthique du dialogue ne se résume pas à un simple échange de paroles. Elle suppose que l’on respecte certaines règles, comme être de bonne foi, écouter, accepter l’objection, être prêt à reconnaître ses erreurs… Car le langage de la confiance doit permettre la recherche d’une vérité partagée dans le dialogue.
Selon Stephen M.R. Covey, 13 attitudes améliorent sensiblement votre capacité à instaurer la confiance dans toutes vos relations, aussi bien personnelles que professionnelles :
3ème vague : la confiance organisationnelle
Le principe d’intégration
La confiance organisationnelle montre comment les leaders peuvent susciter la confiance dans tous types d’organisations et d’équipes. Le principe-clé qui sous-tend celle-ci est l’intégration.
La priorité pour tout dirigeant ou manager est de s’attacher à instaurer la confiance en soi et la confiance relationnelle autour de lui, et bien entendu à obtenir la confiance de ses équipes. Pour favoriser la confiance organisationnelle, il doit s’employer à piloter sa structure, sa stratégie, ses processus en s’appuyant sur les 4 fondements et les 13 attitudes que nous venons d’appréhender dans les deux premières vagues. Il s’agit ici d’intégrer les méthodes qui développent la confiance dans tous les rouages de l’organisation.
Procédures bureaucratiques, règles pointilleuses ou inéquitables, attitude inadaptée d’un dirigeant sont autant de symboles, de représentations d’une culture d’entreprise, et de ce qui ne fonctionne pas dans une organisation. Il convient donc pour les responsables d’harmoniser l’organisation et ses méthodes avec les principes qui développent la confiance.
Et, dans votre entreprise, dans votre organisation à vous, qu’en est-il des symboles ? Quel message adressent-ils à vos collaborateurs en interne ? Ces symboles sont-ils en accord avec les principes qui créent un haut niveau de confiance ? Et quels sont les résultats ? Pour améliorer l’intention organisationnelle, assurez-vous que votre mission et vos valeurs reflètent des motivations et des principes qui permettent de bâtir la confiance.
4ème vague : la confiance du marché
Le principe de réputation
La confiance du marché se joue tout entière sur la marque ou la réputation. Elle repose sur un sentiment : celui qui va vous faire acheter des produits ou des services, investir votre argent ou votre temps, ou recommander cette marque à vos relations.
La confiance du marché concerne des acteurs extérieurs. Il s’agit des fournisseurs, des distributeurs et des investisseurs ou des clients, mais le plus simple à ce stade pour vous c’est de les considérer comme vos « clients ».
Si une organisation renforce ses quatre fondements et adopte les treize attitudes avec ses clients, elle sera capable d’accroître sensiblement la valeur de sa marque. Ces fondements et ces attitudes sont les clés de la construction de la crédibilité et de la confiance sur le marché. Et, n’oubliez pas : la confiance que vous serez capables de créer dans votre organisation et sur le marché résultera de la crédibilité que vous aurez d’abord créée en vous-mêmes.
5ème vague : la confiance sociétale
Le principe de la contribution
Une société à confiance élevée est une société d’abondance dans laquelle chacun a plus de choix et de possibilités. L’axiome n° 1 de la confiance sociétale est la contribution. C’est l’intention de créer de la valeur plutôt que d’en détruire, de donner plutôt que de prendre, qu’il s’agisse d’individus qui cherchent à se rendre utiles ou de grandes sociétés qui acceptent de servir non seulement leurs actionnaires, mais toutes leurs parties prenantes à travers leur visée humanitaire ou sociale.
L’essentiel des contributions qui donnent leur âme à nos sociétés est le fait d’individus ordinaires qui, un peu partout dans le monde, apportent leur pierre à l’édifice commun.
Comme nous le confie Stephen M.R. Covey : « C’est vous et moi qui prenons la décision consciente de valoriser et d’investir dans le bien-être des autres. C’est vous et moi qui répercutons cette décision dans tous les aspects de notre vie. »
Nous voyons avec cette cinquième vague combien la confiance rayonne à partir de l’estime de soi, avant de se propager à nos relations, à nos organisations et puis au marché, pour s’étendre à la société dans son ensemble. La citoyenneté est un choix individuel qui engage une vie entière. Et quand nous faisons ce choix dans notre vie, nous incitons celles et ceux avec qui nous travaillons et vivons à faire des choix aussi positifs dans leur propre vie. Ensemble, nous bâtissons des organisations et des familles qui contribuent au bien-être du monde.
Il m’a fallu plus de 20 ans pour comprendre que j’avais choisi le métier de la communication non pas pour développer des outils mais pour créer du lien autour de moi. C’est l’exercice du management qui m’a ouvert les yeux. La responsabilité que porte le manager par son intention, par sa posture et son discours, à donner du sens, à engager ses collaborateurs et à prendre soin de ses interactions avec son équipe. Comme il se doit également d’incarner le modèle de relation qu’il souhaite voir se développer entre ses collaborateurs.
C’est bien là tout l’enjeu de notre société à mon sens. Quels liens voulons-nous tisser avec nos « semblables » ? Ce mot, « semblables », peut paraître désuet mais il me semble traduire qu’au-delà des cultures, des communautés, des statuts, des niveaux hiérarchiques, des classes d’âge…, nous sommes avant tout des êtres sociaux, et à ce titre, nous nous devons de prendre soin les uns des autres dans nos relations interpersonnelles, notamment à travers notre langage. Car le langage est un phénomène social de premier ordre au travers de ses fonctions d’expression et de communication. Il participe ainsi à la sociabilisation de l’individu.
Pour autant, nos modes de vie en accéléré et le tumulte des réseaux sociaux peuvent nous faire perdre de vue la valeur du langage dans nos interactions au quotidien. Comment le choix d’un mot, en fonction de la charge émotionnelle qu’il véhicule, peut faire basculer une relation, une situation, une action… dans une dynamique positive ou négative. Comment une conversation, faute d’attention portée au mode de fonctionnement ou à l’état émotionnel de notre interlocuteur, peut tourner au « combat de mots » et finir dans une impasse…
Comme le souligne Jeanne Bordeau dans son récent ouvrage Le nouveau pouvoir du langage : « La langue de notre époque perd une part de sa chair et se doit d’être courte, brève et péremptoire dans un monde accéléré (…) Vélocité de l’information, diffusion immédiate de concepts grandiloquents, le tout à l’info flash, vient hystériser des informations qu’il faut rendre spectaculaires. Sans hiérarchie, sans cohérence, sans vision, le langage circule dans tous les sens et en devient « in-sensé ».
Le langage est d’autant plus précieux qu’il est vecteur de sens, qu’il donne de la clarté à nos idées pour relier et faire cohabiter des faits et des ressentis profonds souvent paradoxaux.
A travers l’éclairage de Jeanne Bordeau et quelques autres lectures, je vous invite à prendre toute la mesure du pouvoir du langage. Car le langage nous fait exister, par notre compréhension du monde, par l’expression de nos idées, de nos émotions. Et en nous reliant, il nous fait exister aux yeux des autres. Il nous signe, nous dessine et dit qui nous sommes. En créant un monde commun dans le dialogue, le langage est source d’humanité… Cultiver son langage, c’est donc prendre soin de soi et des autres et se projeter dans la relation avec attention et plaisir !
Le langage est nécessaire à la construction de liens sociaux dans le sens où il favorise la communication. Vivre ensemble suppose un minimum d’échanges et de coordination, donc un minimum de communication entre les membres d’une communauté. Le langage permet ainsi d’élaborer un monde commun ; il s’inscrit dans une relation à travers laquelle chacun peut exprimer des pensées, des émotions, des valeurs, des besoins… et partager des informations, des connaissances, des intentions… En cela, le langage est un mode d’accomplissement privilégié car il nous fait exister pour soi et à travers les autres.
Le langage peut donc être fondateur de la société en tant qu’agent de liaison, d’échange et d’intégration. Mais le langage peut également devenir facteur de division, soit de façon inconsciente, en étant source de malentendu ou de maladresse, soit de façon consciente, en devenant un instrument de manipulation, de mensonge et de domination.
Toutefois, quelle que soit l’origine de ces divisions et tensions sociales, elles ne pourront se résoudre que par l’intermédiaire du langage construit sur une véritable éthique de communication fondée sur le dialogue !
Comme l’exprime très justement Abdelbasset Fatih, professeur agrégé de lettres modernes, dans son article Le langage dans la société : « Ce qui fait vraiment de la société un espace humain, ce n’est pas le langage mis au service des appétits de pouvoir et de domination, ce n’est pas le langage qui divise et qui exclut mais le dialogue qui jette les ponts entre les humains ».
Dans son article, Abdelbasset Fatih aime à citer la politologue, philosophe et journaliste Hannah Arendt : « Pour Hannah Arendt, c’est parce qu’ils peuvent parler ensemble sur ce qui les concerne tous que les hommes peuvent partager la même vie et le même monde. Le dialogue est pour elle bien plus qu’une condition de la vie en société, il est un critère majeur d’humanité ».
Pour tendre vers une éthique de la discussion, les interlocuteurs doivent s’accorder sur les critères de réussite du dialogue et sur le fondement de ce dialogue qui les réunit, à savoir la volonté d’entendre ce que dit l’autre et d’accepter ce qui nous sépare : « L’aptitude de dialogue implique le dépassement de l’égocentrisme, du dogmatisme et des préjugés pour tenter d’entendre ce que dit l’autre ». Un dialogue fondé sur le respect et la dignité de chacun.
Cette éthique du dialogue ne se résume pas à un simple échange de paroles. Elle suppose que l’on respecte certaines règles, comme être de bonne foi, écouter, accepter l’objection, être prêt à reconnaître ses erreurs... Car le langage doit permettre la rechercher d’une vérité partagée dans le dialogue. Et pour accéder à cette vérité, il peut être judicieux d’adapter son langage à celui de l’autre pour en favoriser la compréhension mutuelle.
Dans son article intitulé Le langage contribue-t-il à unir ou à diviser les hommes ? Maryvonne Longeart, Docteur en philosophie, souligne : « La parole échangée suppose la recherche d’une vérité partagée et non la pure affirmation dogmatique d’une opinion. Dans l’échange, on est prêt éventuellement à changer de point de vue ».
Elle illustre son propos en reprenant la métaphore de Maurice Merleau-Ponty pour qui « dans l’expérience du dialogue, il se constitue entre autrui et moi un terrain commun, ma pensée et la sienne ne font qu’un seul tissu ». On peut voir ici une référence aux deux fils d’un tissage : la trame et la chaîne ; l’un des interlocuteurs fournit la trame, l’autre la chaîne et la signification commune - le tissu commun - est la résultante des deux.
Pour sa part, Abdelbasset Fatih vise une véritable « esthétique du dialogue. Autrement dit l’art de parler qui consiste à rendre l’échange agréable pour les deux parties. Il s’agit bien ici du plaisir qu’on éprouve en parlant à autrui ou en l’écoutant, car la société des hommes, c’est aussi cela ».
Nous sommes tous familiers de ce dialogue qui tisse des liens et forge la relation. Le plaisir de s’ouvrir à un échange authentique et sincère, dans lequel chacun se sent libre d’incarner son histoire et sa sensibilité, sans phare ni faux semblants. Un dialogue qui s’enrichit des expériences de chacun et qui permet à un langage vivant et en mouvement de rebondir d’une idée à l’autre. Un dialogue prolongé qui ouvre des horizons infinis et stimule le pouvoir d’agir… Car comme le suggère Hannah Arendt : « Les mots justes, trouvés au bon moment, sont de l'action ».
Jeanne Bordeau scrute les métamorphoses du langage dans les entreprises. Pour elle, les évolutions du langage de l’entreprise et de la marque sont éloquentes car elles sont le reflet des transformations sociétales et des nouvelles attentes des « consomm’acteurs ». C’est aussi le langage qui exprime la culture des organisations et façonne leur relation avec l’ensemble de leurs parties prenantes.
Elle voit émerger un langage responsable et attentionné, incarné par des « entreprises qui ont une âme » et qui parlent avec cœur et raison au plus près de l’oreille de leurs clients. Pour adopter le ton juste, elles fondent leur langage sur la « parole source » de leurs équipes et des personnes de métiers et d’expertise. Une « langue de preuve » héritée d’un savoir-faire et d’un savoir-être incarnés, une langue fiable et juste chargée d’une histoire et de la sédimentation d’une culture.
Néanmoins, si le langage des entreprises est aujourd’hui construit pour susciter plaisir et émotion auprès de ses clients, il doit viser les mêmes vertus en interne… Une Symétrie des attentions qui pose comme principe fondamental que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est symétrique de la qualité de la relation de cette entreprise avec l’ensemble de ses collaborateurs. [à lire aussi : Collaborateur vs Client ? Et si on visait plutôt l’alignement des expériences…] C’est pourquoi, ce langage empreint de justesse et d’attention doit également s’ancrer au cœur de l’entreprise, dans les relations interpersonnelles, en exprimant de l’écoute, de la bienveillance et de la considération. Fort heureusement, les organisations ont pris conscience de l’enjeu de capitaliser sur l’intelligence relationnelle de leurs forces vives en investissant le champ de la communication interpersonnelle. Parce que l’entreprise est un organisme vivant, elle construit sa valeur économique sur les multiples connexions tissées entre ses différentes parties prenantes. Elle a ainsi la capacité à redonner au langage ses lettres de noblesse dans ses rangs. Pour Jeanne Bourdeau : « mieux on maîtrise le langage, mieux l’on va » car formaliser et dire avec justesse libère de ce que nous ressentons et ouvre la voie à des échanges constructifs et sincères.
L’entreprise a également pour mission de cultiver un dialogue de qualité qui prend sa source au cœur du travail. [à lire aussi : Manager, c’est se réapproprier l’essence (les sens) de la communication… et favoriser le dialogue] Donner la parole aux collaborateurs pour débattre des règles, des contraintes, des ressources…de leur activité, c’est les reconnaître dans leur autorité sur leur métier et c’est leur donner le pouvoir d’agir au sein de leur organisation, voire en dehors. Elle a donc un rôle déterminant à jouer pour conforter le « vivre ensemble » qui s'y joue et prendre soin de la qualité du lien social qui s'y noue. Car l’entreprise n’est pas hors de la société, elle est la société !
Alors que l’heure de Noël est sur le point de sonner, je suis gagnée par un drôle de sentiment… L’impression que ce Noël pas tout à fait comme les autres inaugure une nouvelle façon de célébrer, plus intime, plus sobre, plus profonde. Resserré autour du noyau familial - tout en gardant les distances – ce moment de partage n’aurait-il pas cette année une saveur particulière ? Noël sera-t-il plus « light » ? Moins de monde autour de la table, mais quitte à être moins nombreux, n’est-ce-pas aussi l’occasion de célébrer la famille plus intensément, avec le cœur grand ouvert ?
Personnellement, en plein lancement de mon activité, avec un mari dirigeant absorbé par ses affaires, une jeune adulte exaltée par de nouvelles libertés et un adolescent cloué devant son ordinateur…, j’avoue être depuis quelques temps désemparée devant l’éclatement de mon cher noyau familial ! A force de se croiser sans se voir, de s’écouter sans s’entendre dans le tourbillon du quotidien, la perspective de ce Noël confidentiel vient réveiller chez moi le besoin de serrer dans mes bras ceux que j’aime. De célébrer ma famille en cette période de fêtes. De prendre le temps de redécouvrir chaque membre de mon clan à la lumière d’un feu de cheminée, au coin du sapin. Un Noël pour retisser les liens qui nous unissent, se témoigner de la gratitude et se dire combien chacun compte.
Le besoin de témoigner de la gratitude en cette veille de Noël, alors que la crise sanitaire couve toujours, semble d’ailleurs avoir gagné la sphère professionnelle. En effet, j’entendais cette semaine à la radio que les entreprises avaient particulièrement choyé leurs collaborateurs cette année pour les remercier de leur contribution exceptionnelle en cette période de Covid. Au-delà du principe de gratification, n’est-ce pas là avant tout l’occasion de célébrer le « clan professionnel » ?
Partout, on entend que la troisième vague de Covid-19 sera celle de la santé mentale, avec une forte hausse des états dépressifs liés aux bouleversements induits par la crise sanitaire. Incapacité de voir le bout du tunnel, solitude, perte de repères…, les sujets d’inquiétude sont nombreux et avec la répétition du confinement et la durée de la crise, les ressources pour s'adapter s'épuisent.
Alors comment profiter de la magie de Noël pour redonner le moral aux troupes ? En célébrant la communauté professionnelle, en retissant les liens de l’équipe, qu’elle soit en télétravail, en chômage partiel ou en petit comité. Rien d’ostentatoire cette année et c’est tant mieux car en entreprise comme au sein de la famille, la proximité est de mise. Il est temps de bannir les grands discours impersonnels déployés à grands renforts d’outils de communication : vidéo du dirigeant, carte de vœux corporate... L’heure est à la simplicité, à l’écoute, à la solidarité. Pour stimuler la bonne humeur, pourquoi ne pas colorer la dernière réunion de l’année, a plus forte raison en visio, en invitant chacun à décorer son environnement de travail aux couleurs de Noël. Et pour les collaborateurs en présentiel, le traditionnel « Secret Santa » qui favorise l’échange de petits cadeaux de façon anonyme constitue également une occasion de se retrouver et d’exalter le plaisir de donner et de recevoir.
Comme en témoignent les dirigeants, managers et collaborateurs de TPE-PME que notre collectif de professionnels de l'accompagnement humain Act4 Talents a interviewés lors du premier confinement dans son étude « Regards croisés », l’humour et la bonne humeur ont été déterminants dans cette période de forte incertitude. L’objectif étant de souder les équipes et de favoriser un contexte propice au dialogue, entre collègues et aussi avec le manager de proximité, pour mieux prendre le pouls de chacun. Parmi les bonnes pratiques qui sont ressorties de l’étude, certains managers ont d'ailleurs eu l’idée de constituer des binômes pour éviter l’isolement en télétravail, stimuler le soutien et la coopération.
Cette crise sanitaire avec ses contraintes de distanciation sociale nous amène nécessairement à revoir le périmètre du clan familial comme professionnel et à privilégier les groupes à taille humaine. Finalement, la Covid ne précipiterait-elle pas un mouvement déjà amorcé depuis plusieurs années selon lequel il fait bon travailler dans les petites structures ?
Les TPE et les PME ont la cote car elles sont réputées pour leur ambiance familiale et rassurante ; la proximité qui y règne est le gage d’échanges plus réguliers et d’une meilleure connaissance des missions de chacun. Les méthodes de travail y sont plus transversales et bien souvent les tâches qui sont confiées aux salariés demandent plus de polyvalence. Grâce à une hiérarchie moins complexe et un processus de prise de décision simplifié, les entreprises à taille humaine peuvent être plus réactives et octroient plus d’autonomie et de liberté à leurs collaborateurs.
Ambiance rassurante, proximité, échanges plus réguliers, polyvalence, réactivité, autonomie… Ce sont précisément les enjeux qui ont émergé de notre étude sur les évolutions du management et de l’organisation à l’épreuve de la crise sanitaire. En travaillant à distance ou au sein d’équipes très resserrées, il a fallu créer des rituels plus réguliers pour rassurer, pour partager sur les besoins de chacun. Afin de maintenir l’activité tout en palliant l’absence de certains de leurs collègues, les salariés ont dû faire preuve de polyvalence. Et tester leur autonomie, en distanciel, loin de leur hiérarchie. Avec à la clé, une explosion de sens pour des individus qui ont ainsi pu activer leur « pouvoir agir » et développer à cette occasion des compétences relationnelles fortes telles que l’écoute, l’empathie et la solidarité.
Cette nouvelle humanité que beaucoup ont pu expérimenter dans cette crise inédite a permis d’exacerber le sentiment d’appartenance et l’engagement au sein des organisations. Elle a porté le sens à un niveau inégalé et révélé des ressources insoupçonnées chez les individus. Elle est à n’en pas douter le meilleur vaccin contre l’épidémie de dépression qui nous menace ! Alors, apprenons à célébrer cette humanité nouvelle au sein de nos clans professionnels. Sachons distribuer la gratitude avec sincérité et générosité à nos collaborateurs les plus proches. Car la gratitude est contagieuse ; elle pourrait bien gagner les moindres recoins de nos organisations !!!
La période que nous traversons est incroyable ! Jamais nos modes de vie n’ont connu autant de remises en question, à travers nos interfaces privées comme professionnelles. La crise sanitaire, subordonnée à un contrôle de nos mouvements et relations, ainsi qu’à une privation de libertés jamais vue dans notre société contemporaine, constitue un révélateur à très grande échelle du pouvoir de la contrainte sur la transformation. Car, à n’en pas douter, le corollaire de cette crise sera notre capacité à s’adapter à ces contraintes et à apprendre de ces nouvelles conditions de vie et de travail.
C’est pour comprendre ces mécanismes de transformation que nous avons entrepris d’analyser les dispositions des organisations et des individus à apprendre de leurs situations de travail pour s’adapter aux mutations qui les bousculent. Au sein d’Act4 Talents, nous avons ainsi créé l’Observatoire des mutations du travail avec une première étude inédite sur la crise de la Covid-19 !
Pendant plus de 15 semaines, du mois d’avril au mois de juillet 2020, nous nous sommes immergés au sein de 24 TPE-PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin d'appréhender comment leur organisation et leur management étaient impactés à l’épreuve de la crise.
Pour bénéficier d’une perception la plus réaliste possible des situations vécues dans les entreprises, nous sommes allés chercher les regards croisés de dirigeants, de managers et de collaborateurs pour confronter leurs perceptions. Nous les avons invités à prendre un peu de hauteur de vue sur l’enchaînement des événements et leurs conséquences. Des paroles vibrantes d’un contexte exceptionnel et d’émotions exacerbées que nous retraçons dans cet observatoire et à la lumière desquelles nous avons identifié 5 enjeux pour se projeter positivement et initier des transformations porteuses de valeurs pérennes dans les organisations.

Pour aller plus loin dans la compréhension des enjeux, nous vous invitons à télécharger l’étude complète sur notre site Act4 Talents.
Au moment de nos échanges avec les entreprises, entre fin mars et juillet, personne ne pouvait présager de la durée et de l’impact de la crise. Il était impossible alors de considérer si les adaptations mises en place par les organisations pendant le confinement allaient contribuer à des transformations durables ou être vite oubliées au bénéfice d’un retour à la normale. Nous portions un espoir collectif que la situation d’état d’urgence que nous venions de traverser ne pouvait qu’être temporaire, que l’été balayerait les effets du virus et que progressivement, nous pourrions revenir à une activité quasi-normale en septembre…
La « trêve » a été de courte durée ! Si dans notre espace privé nous avons pu relâcher un peu les contraintes pendant les vacances estivales, se retrouver en famille, se dépayser et savourer une forme de liberté retrouvée ; dans la sphère professionnelle, point de relâchement. La plupart des entreprises ont dû maintenir un mix présentiel/distanciel pour répondre aux exigences de distanciation sociale, avec l’obligation du port du masque au bureau lors des échanges interpersonnels. Et très rapidement, fin septembre, le spectre d’une deuxième vague a été confirmé avec le durcissement des mesures sanitaires et pour finir l’annonce d’un retour au confinement…
Dans nombre d’organisations, la rentrée de septembre a été vécue comme une « gueule de bois ». Après des vacances en demi-teinte, sans liberté de voyager à notre gré, à moitié masquées, bercées par de nombreuses inconnues… Le retour au travail a été froid et atone, en présentiel, amputé d’une partie des collègues ou en distanciel sans la possibilité d’échanger autour d’un café sur les plaisirs de vacances… Dans un de ces récents articles, Pierre-Yves Gomez, économiste et professeur à EM Lyon, voit dans cette période les signes d’une dépression collective : « Le fait que les choses ne reprennent pas « comme d’habitude » est déroutant. La société semble perdre ses repères ».
Une dépression en cascade avec des salariés perdus et démotivés, des managers désemparés par l’ampleur de la tâche, et des dirigeants fragilisés par de longs mois de bataille pour maintenir leur entreprise à flot et engourdis par le poids des responsabilités à faire respecter les mesures barrières dans les bureaux. Car toutes ces contraintes qui entravent notre autonomie, ce contrôle de nos moindres faits et gestes pour endiguer l’épidémie, contribuent in fine à bloquer notre énergie. Après de années d’une course effrénée vers le « toujours plus », nous avons été brutalement stoppés dans notre élan le 17 mars 2020. Nous avons alors fait l’expérience de l’immobilisme, du sur place. Un changement de rythme déstabilisant qui nous a amenés à nous questionner sur les fondamentaux de la condition humaine et à observer, grâce à la prise de recul qui nous était offerte alors que nous étions confinés, la vacuité de notre vie en mode accéléré. Sept mois plus tard, alors que la crise s’éternise, nous sommes réduits à un mouvement fatalement ralenti et de plus en plus sujets à l’inconfort de la privation de liberté. Une nouvelle réalité qui vient percuter la réalité antérieure, celle de l’exhortation au mouvement.
Face à cette perte de repères qui peut être synonyme d’angoisses, Pierre-Yves Gomez nous engage à nous focaliser sur les habitudes prises dans cette nouvelle réalité. Comme nous vous y invitons dans notre étude Regards croisés : observer comment les circonstances ont fait évoluer nos pratiques de travail et créer l’espace pour un dialogue ouvert et sincère dans lequel chacun pourra exposer son expérience du travail pendant cette période de crise. Dresser le bilan de ce que l’on a perdu et de ce que l’on a gagné individuellement et collectivement à travers cette épreuve. Tirer les enseignements de ce qui a fonctionné et de ce qui ne fonctionne plus aujourd’hui dans nos pratiques de travail pour construire ensemble un futur souhaitable.
Selon Pierre-Yves Gomez, « Pour accompagner le changement, il faut ne pas se concentrer sur ce que l’on perd, le monde frénétique d’hier. Il faut rendre la nouveauté du monde désirable, appétissante. On n’assiste pas à l’effondrement du monde d’avant – d’ailleurs beaucoup de choses vont perdurer – mais à l’émergence de comportements nouveaux et intéressants. A ce que nous ferons des occasions qui nous sont offertes. »
Les 5 enjeux qui ressortent de notre étude qualitative, constituent le socle de ce processus de dialogue qu’il nous semble impérieux d’animer au sein des équipes afin de favoriser l’expression des humanités du travail. De quoi parle-t-on lorsque l’on évoque les humanités du travail ? Pour comprendre quel est l’impact de cette crise sur les individus au travail, il faut développer une compréhension de la sensibilité des humains à l’égard des autres dans cette période exceptionnelle. Sans l’intégration de cette compréhension dans les modèles de management, aucun dirigeant ou manager ne sera en mesure d’appréhender l’explosion des émotions suscitées par ce contexte contraignant.
Boris Cyrulnik nous explique que donner l’occasion d’exprimer ses émotions, ses ressentis, modifie les perceptions du passé. Quand on est vulnérabilisé par un événement de la vie ou une situation particulière, on a la possibilité de remanier la représentation du réel par le récit que l’on en fait. On trouve ainsi la liberté d’agir par nos récits pour remanier intentionnellement le réel et mieux vivre ensemble. Lorsque ces récits sont collectifs, partagés avec quelqu’un ou un groupe en qui on a confiance, la parole a une fonction affective et socialisante. Cette parole est d’autant plus précieuse aujourd’hui, alors que nous travaillons dans un mix distanciel/présentiel et que nous ne communiquons plus avec nos collègues que derrière un écran ou à travers un masque. Des filtres à émotions particulièrement efficaces ! Il nous faut donc aller chercher les émotions masquées à travers le récit collectif et réapprendre à travailler ensemble en permanence.
Les entreprises ont la responsabilité d’investir pleinement ces territoires d’engagement que sont le management et l’organisation pour permettre à leurs collaborateurs de transformer l’épreuve qu’ils traversent actuellement en expérience dont chacun pourra tirer du positif. Pour commencer ce travail de co-construction, un temps de prise de recul s’impose. Un temps pour libérer la parole et écouter les besoins de chacun. Un temps pour permettre au collectif de se retrouver et à la coopération de reprendre corps sereinement. C’est sur le terrain de l’échange que l’on pourra explorer les impacts de la crise et tirer les enseignements sur ce qui a fonctionné et ce qui ne fonctionne plus. Reconsidérer et réajuster nos anciens modèles pour imaginer d’autres alternatives. Et enfin, accepter de désinvestir le superflu et de se recentrer sur l’essentiel.
A la lumière de nos 5 enjeux, quelles sont les questions à se poser collectivement pour se projeter positivement et initier des transformations porteuses de valeurs pérennes dans nos organisations ?
Ce que nous révèle l’étude Regards croisés en premier lieu, c’est le formidable regain d’humanité qui a transcendé les organisations au travers de cette crise. Cohésion, adaptation, créativité, intelligence relationnelle, vouloir agir, sens, sentiment d’appartenance, liens, confiance… sont autant de termes qui illustrent ces vécus collectifs et témoignent de l’amorce d’un changement culturel vers plus d’entraide et de solidarité. Le prolongement de notre étude nous conduira à réinterroger dirigeants, managers et collaborateurs afin de déceler les apprentissages profonds qui se seront matérialisés au fil des mois. Nous serons ainsi en mesure de confirmer ou d'infirmer la tendance selon laquelle cette crise pousse vers une plus grande humanisation de la gestion des organisations.
Nous vivons aujourd’hui un véritable renversement de valeurs ! Alors que la plupart des pays d’Europe se mettent en situation de sacrifier leur économie pour sauver des vies humaines, comment ne pas réinterroger la place des hommes et des femmes dans les organisations. Cette crise « existentielle » qui impacte respectivement l’existence des entreprises et celle des humains, peut-elle être le terrain d’une réconciliation entre performance économique et réalisation humaine autour de nouvelles valeurs de travail ?
Quelques lectures et une vidéo inspirante : L'OBS - Comment la crise du Covid a sonné la fin du « toujours plus » THE CONVERSATION - Transformation numérique : comment ne pas manquer la phase qui s’ouvre dans le travail ? YOUTUBE - Boris Cyrulnik - Le récit de soi
Tiraillés, désorientés… les adjectifs sont nombreux pour traduire l’impact du déconfinement à venir, sur notre rapport au travail. Entre la perspective d’un retour au bureau, avec son lot de contraintes logistiques dans un contexte inédit de distanciation sociale et d’incertitudes : reprise de l’école, accès aux transports en commun, retour en open space, réunions en présentiel… et le maintien à domicile où une nouvelle réalité de travail s’est installée, tant sur le plan matériel que de l’organisation, pour beaucoup d’entre nous, la balance penche naturellement du côté de l’alternative rassurante du télétravail. Petit retour en arrière pour bien cerner la situation…
L’annonce du confinement à la mi-mars, à la fois prévisible et crainte, provoque sidération et chaos dans les organisations. Entre l’obligation de stopper certaines activités avec des mesures de chômage partiel à mettre en œuvre, et la poursuite du travail à coordonner, avec des sites de production à sécuriser et le déploiement massif du télétravail à marche forcée, les deux dernières semaines de mars ont mobilisé des trésors d’agilité et de créativité des équipes dans les entreprises. Une période de dérèglement s’ouvre alors, qui entraîne pour tout un chacun l’obligation de s’ajuster à de nouvelles règles de fonctionnement et à sortir de sa zone de confort. Une situation exceptionnelle qui va chercher profondément dans nos ressources adaptatives et face à laquelle nous ne sommes pas égaux. Elle provoque pour certains des postures de blocage et de résistance confortées par la durabilité des incertitudes, alors que pour d’autres, on assiste à un déblocage de potentiels et le développement de nouvelles possibilités. Cette phase d’apprentissage, qu’elle soit vécue positivement ou négativement, est déterminante pour s’engager dans le plan de déconfinement partiel annoncé à partir du 11 mai.
Car c’est à ce stade que les tiraillements se font les plus forts, notamment pour les collaborateurs qui ont quitté leur bureau le 16 mars dernier et qui depuis ont eu le temps de prendre leurs marques à leur domicile. Même si, pour la grande majorité d’entre eux, il a fallu au moins deux semaines pour organiser leur espace de travail, récupérer du matériel informatique, organiser les journées entre le temps consacré aux enfants, aux repas et au travail… ; après plus d’un mois, une nouvelle réalité, comme une forme de routine, s’est installée. Un cadre familier et sécurisant, bien que souvent précaire, chez soi, qui tranche avec les inconnues qui planent encore sur les conditions d’un retour au bureau, au-dehors.
Alors que le gouvernement a expressément demandé aux entreprises de maintenir le télétravail après le 11 mai, partout où c’est possible, au moins dans les trois prochaines semaines. Et que la pratique des horaires décalés est encouragée pour les personnes qui ne pourront pas télétravailler. Quelle perspective nous donne ce plongeon forcé dans les nouvelles formes de travail ?
Aujourd’hui en confinement, 33% des salariés travaillent à leur domicile alors que seulement 6,6% étaient en télétravail avant la crise du Covid-19. Une continuité de travail qui tient plus du bricolage que du télétravail, certes ! Il peut d’ailleurs être utile de rappeler que la notion de « télétravail » est très normée en France. Si un salarié a l’opportunité de travailler à distance de son entreprise avec l’accord verbal de son employeur, il n’est pas techniquement en télétravail sauf à l’avoir formalisé contractuellement en précisant les conditions d’exécution du télétravail (jours, plages horaires…). Mais ne jouons pas sur les mots ! A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Et ce contexte que vivent actuellement au moins 8 millions de salariés, selon le ministère du Travail, s’apparente bien au télétravail, qu’il soit contraint, confiné, bricolé... Jusqu’ici, beaucoup d’entreprises n’avaient pas pris la mesure de ce qu’était le télétravail. Perçu comme un palliatif à une activité en présentiel, il n’était pas du tout pensé comme une nouvelle manière de pratiquer le travail. Il semble que cette perception soit en train de changer à l’épreuve du réel. Même les plus réfractaires, du côté des salariés, semblent avoir pris goût à l’exercice. Certains dirigeants y voient aussi un moyen de décrocher de leur quotidien bousculé pour échafauder des stratégies et construire des projets dans le calme de leur foyer. Quant aux entreprises, plutôt récalcitrantes, certaines études montrent que le travail à distance pourrait devenir la norme à mesure qu’elles se rendent compte qu'elles peuvent être aussi efficaces tout en économisant de l'argent sur l'immobilier commercial.
Et ce n’est qu’un début… Les effets collatéraux du travail à distance sont nombreux. Que dire de la démocratisation des outils numériques de visioconférence ou de webinar, de l’accélération de la dématérialisation de la relation clients et fournisseurs ? La transformation digitale, encore à la peine dans nombre de PME, est passée à la vitesse supérieure pour maintenir l’activité à distance. On a sorti les projets des tiroirs pour les déployer dans l’urgence, parfois même en profitant du confinement pour former les salariés à ces nouveaux outils, en distanciel, bien sûr !
C’est dire si tous les acteurs de l’entreprise ont su faire preuve de réactivité, d’adaptabilité, de créativité, voire de solidarité en s’épaulant pour se concentrer sur des missions vitales. Une situation inédite qui a mis tous les échelons de l’organisation, des dirigeants aux collaborateurs, en passant par les managers de proximité, dans une posture d’apprentissage inégalée. Chacun a été amené à revoir ses croyances, son périmètre d’intervention, ses modes de fonctionnement, pour les ajuster et trouver sa place dans cette nouvelle réalité. Un tournant dans l’organisation du travail qui a fait émerger un nouveau « patrimoine de compétences » sur lequel les entreprises devront capitaliser.
La question du management est également au cœur de ce grand chantier de transformations ouvert par la crise du Covid-19. Car pour maintenir la mobilisation des équipes, il a fallu être à l’écoute et prendre en compte les besoins individuels des uns et des autres. Et surtout, à travers l’autonomie libérée par le télétravail, les managers ont dû apprendre à faire confiance à leurs collaborateurs. Apprendre à laisser leurs talents s’exprimer en dehors d’un cadre contrôlant. Et adopter une posture de soutien et de créateur de liens pour maintenir le sens et la cohésion au quotidien.
Après avoir expérimenté le télétravail, à l’heure du déconfinement, les entreprises sont invitées par le gouvernement à pratiquer les horaires décalés afin d’éviter à leurs collaborateurs la promiscuité dans les transports en commun, notamment dans les grandes villes. Indépendamment des métiers nécessitant un travail de nuit et le week-end, coutumiers de cette pratique, ce test à grande échelle peut constituer une réelle ouverture pour des salariés qui aux « heures de bureau » sont systématiquement confrontés aux bouchons et bousculades dans les transports. Une opportunité de mesurer la compatibilité de leur mission avec un travail en décalage de temps avec leurs collègues.
Cette accélération des transformations qui saute aux yeux est éclairante sur un point : « en temps de crise, on n’attend pas le changement mais on saisit l’opportunité des nouvelles conditions de l’action pour le créer. »
Regardons le côté positif, cette épidémie du Covid-19, a contraint les individus à activer leur esprit critique et leur créativité pour ajuster leurs connaissances et contribuer à assurer, à leur échelle, la continuité de l’activité économique. A l’échelle des organisations, la crise a favorisé le déploiement d’un terrain d’expérimentation exceptionnel sur les nouvelles pratiques de travail et engagé les entreprises dans une transition que l’on peut entrevoir comme progressive, mais durable.
Comme le souligne Vincent Berthelot, consultant RH auprès des entreprises : « Ce formidable travail d’ajustement mutuel va nous faire gagner plusieurs années dans l’évolution des relations et modes de travail tant du point de vue du style de management, du sens du travail que de l’expérience salarié. Nul doute que les managers qui auront réussi avec leurs équipes à assurer une continuité dans le travail seront les premiers bâtisseurs de l’entreprise de demain basée sur la confiance, les compétences et l’engagement des salariés. »
Comment imaginer que les semaines cumulées de confinement puis de déconfinement n’auront pas marqué de leur empreinte notre vision individuelle et collective du travail. Que cette expérience ait été vécue positivement ou négativement, elle appelle nécessairement un changement.
« Il s’est passé trop de choses pour que tout revienne comme avant » souligne Philippe Silberzahn, professeur à emlyon business school et co-auteur de l’ouvrage Stratégie Modèle Mental. « Ce monde d’aujourd’hui va changer, ni révolution, ni retour en arrière, et il faut le construire. »
Et pour construire le monde d’aujourd’hui, nous allons devoir mobiliser beaucoup d’énergie et d’enthousiasme. Un simple effort de relance ne suffira pas. Les entreprises auront la responsabilité d’investir pleinement ces territoires d’engagement que sont le management et l’organisation pour permettre à leurs collaborateurs de transformer l’épreuve qu’ils viennent de traverser en expérience dont chacun pourra tirer du positif. Pour commencer ce travail de construction, un temps de prise de recul s’impose. Un temps pour libérer la parole et écouter les besoins de chacun. Un temps pour permettre au collectif de se retrouver et à la coopération de reprendre corps sereinement. C’est sur le terrain de l’échange que l’on pourra explorer les impacts de la crise et tirer les enseignements sur ce qui a fonctionné et ce qui ne fonctionne plus. Reconsidérer et réajuster nos anciens modèles pour imaginer d’autres alternatives. Et enfin, accepter de désinvestir le superflu et de se recentrer sur l’essentiel.
Nous pouvons aussi apprendre du formidable élan d’intelligence collective qui galvanise les milieux scientifiques du monde entier pour circonscrire l’épidémie de Covid-19. Une communauté massive aux compétences variées s’est mobilisée pour partager la connaissance : accès gratuit aux publications, plateformes ouvertes de travail collaboratif, équipes auto-organisées… Les entreprises de leur côté n’ont pas hésité à se mettre en réseau pour innover et répondre à l’urgence sanitaire. Des partenariats qui pourraient survivre à la crise et donner lieu à de nouvelles coopérations, généreuses et inspirantes, pour construire ce monde qui donne du sens et parle à nos valeurs.
Quelques lectures inspirantes COURRIER CADRES - Coronavirus, confinement et management : Ceci n’est pas du télétravail ! Blog de Philippe Silberzahn - La course à « l’après » coronavirus: Le festival des lampadaires est ouvert CADRE & DIRIGEANT MAGAZINE - Dépasser la crise COVID 19 en s’appuyant sur la dynamique et la puissance des équipes FORBES - Télétravail Et Confinement : Dessiner Le Travail De Demain THE CONVERSATION - Comment le coronavirus a réveillé l’intelligence collective mondiale
Lorsque l’on franchit la porte du « camp de base » d’Oslandia, en plein cœur de Lyon, on perçoit au premier coup d’œil ce qui fait la spécificité de cette entreprise : quelques postes de travail répartis en hexagone dans un open space , de grandes parois transparentes, un petit salon très cosy où sont installés les invités. Pas de téléphone qui sonne, pas de bruits de conversation, l’ambiance qui règne ce jour-là est particulièrement feutrée…
Je suis accueillie par Jeanne Cartillier, chief office manager (à défaut d’une appellation en français adaptée à la nature et la diversité de ses tâches), dont la mission est d’assurer le bon fonctionnement global de l’entreprise en pilotant notamment l’administration générale, les ressources humaines, les finances et la comptabilité, la communication, mais également l’organisation interne et la vie d’une équipe distribuée… Une fonction que Jeanne assume avec l’appui d’Inès, assistante Office Manager en contrat de professionnalisation, aux côtés de Vincent Picavet, cofondateur et CEO de l’entreprise, à partir du « camp de base » de Lyon.
Je reviens volontairement sur cette appellation de « camp de base », recueillie dans la bouche même de Jeanne, qui marque la singularité d’Oslandia. Et pour bien comprendre ce que traduit cette idée, j’ai cherché à quelle définition elle se rapportait… Après avoir écarté les notions de « lieu de stationnement d'une unité militaire » ou de « campement où l'on plante sa tente », je me suis arrêtée sur une définition bien plus conforme à l’environnement tel que je le découvrais : « partie, par opposition à une ou plusieurs autres parties »… Car ce « camp de base » n’est qu’une petite partie d’Oslandia ; le socle d’une « équipe distribuée », organisation très répandue dans le secteur de l’IT. Secteur dont est issue l’entreprise, spécialisée dans l’architecture de Systèmes d’Information Géographiques et le développement de logiciels cartographiques open source.
Pour comprendre le choix de cette organisation, il faut revenir à la création d’Oslandia, en 2009, par deux cofondateurs situés l’un à Paris et l’autre à Chambéry. Le travail à distance s’est naturellement imposé du fait de l’éloignement géographique des deux associés mais aussi comme un modèle d’entreprise naturel pour des profils de développeurs rompus au travail nomade. Depuis lors, la totalité des recrutements des fonctions de production (profils d’ingénieurs-développeurs) est assurée en 100% télétravail.
Si le recours au télétravail est courant dans l’IT, car il permet notamment d’attirer les meilleurs talents, quel que soit leur lieu de vie, et ainsi de consolider une richesse d'expertise ; les équipes qui travaillent 100% à distance sont néanmoins encore relativement rares. Et pour cause… L’impact de ce modèle est certes inestimable en termes d’agilité et de liberté d’action ; pour autant, il nécessite un cadre extrêmement structurant et une exigence suprême en matière d’organisation.
Forte de 10 ans d’existence, Oslandia est une PME mature. Une maturité éprouvée jusque dans ses effectifs, dont la moyenne d’âge est de 35 ans, qui permet à l’entreprise de partager une vision et un socle de valeurs communes, fondés sur la responsabilité et l’autonomie.
L'équipe d'Oslandia s'est habituée au fait que l’entreprise soit régulièrement rangée du côté des startups dans les salons, et cela fait sourire : « Nous ne sommes pas une startup, non seulement du fait de nos dix ans d’existence, mais également car nous ne sommes pas dans une logique de levée de fonds. Notre modèle est celui d’une PME en croissance raisonnée. »
En qualité d’éditeur et d’expert en logiciels open source, Oslandia contribue activement à l’évolution des logiciels cartographiques libres et s’engage dans la communauté open source, via ses projets clients mais également par une politique d’entreprise affectant 10% du temps de travail de ses collaborateurs (soit environ 20 jours par an) à de la contribution open source laissée au libre choix de chacun.
La dimension open source chez Oslandia constitue à la fois un socle de valeurs communes, un modèle économique et un cercle vertueux qui favorisent l’excellence technique et l’émulation grâce à des modes de fonctionnement comme l’évaluation par les pairs (Peer Review).
« La culture open source façonne un état d’esprit d’humilité car elle encourage la contribution individuelle à un bien commun. Chez Oslandia, cela se traduit notamment par une posture d’ouverture à la discussion, à l’argumentation, et son corollaire : l’écoute et la capacité à se laisser convaincre. »
Le télétravail participe aussi pleinement à un cadre de confiance revendiqué par Oslandia. Concrètement, le télétravail s’illustre par une auto-organisation du temps de travail et des horaires flexibles, à travers le forfait jour fixé par accord d’entreprise, qui offrent une grande liberté aux collaborateurs pour concilier leur vie professionnelle et personnelle. Le travail à distance est un aiguillon incitant à défricher et tester sans cesse de nouvelles méthodes de collaboration pour tendre vers l’efficience.
« C’est très stimulant car on invente des modes de fonctionnement adaptés à nos besoins au fur et à mesure qu’ils se dessinent, avec parfois des zones grises juridiques avec lesquelles nous devons composer ! Le télétravail est un défi quotidien à partir duquel nous avons bâti notre modèle managérial. Une hygiène de travail qui nous oblige à penser notre organisation avec le maximum d’attention. »
Chez Oslandia, l’autonomie et la responsabilisation de chacun des collaborateurs et collaboratrices s’adosse à un cadre et des process structurants, au prix d’une exigence forte. L’organisation et l’animation d’une équipe distribuée est synonyme de véritables défis managériaux, parmi lesquels : la cohésion d’équipe au quotidien, ainsi que le partage de l’information et la transparence.
Dans le cadre d’une organisation basée à 100% sur le travail à distance, sans interactions régulières en présentiel, comment permettre de tisser des liens étroits entre les collaborateurs et collaboratrices ? Le premier enjeu pour l’entreprise est donc de souder l’équipe autour de valeurs communes et de créer les conditions d’une interconnaissance approfondie et d’échanges réguliers, formels et informels, pour nourrir l’esprit d’équipe.
Si l’attention à la dimension humaine et collective est au cœur du modèle d’organisation en télétravail d’Oslandia, cette attention cultivée en continu est centrale dans les missions de Jeanne. Cela se traduit par une palette de rendez-vous et rituels aux objectifs complémentaires et structurants.
Les « sessions corpo », des séminaires résidentiels dans des lieux d’exception « au vert » qui réunissent trois fois par an l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices, en constituent la pierre angulaire. D’ailleurs, sauf cas de force majeure, personne ne manque à l’appel de ces quatre jours intenses de cohésion et de co-production autour du projet d’entreprise.
« Les « sessions corpo » demandent un gros travail de préparation pour passer au tamis les sujets prioritaires à aborder que ce soit au niveau stratégique, technique, organisationnel… pour stimuler l’intelligence collective et coproduire des feuilles de route opérationnelles sur chacun des thèmes abordés. »
Indépendamment des temps de détente et de convivialité, chaque session se déploie autour de séquences rituelles qui constituent des repères dans la culture du travail en équipe :
Lorsqu’exceptionnellement un collaborateur vient à manquer à l’appel de ce temps fort de la vie de l'entreprise, un binôme se voit confier la mission de réaliser un vlog (courte vidéo) rétrospectif de chaque journée, mémoire vivante du séminaire.

Ces « sessions corpo » sont précieuses pour consolider le sentiment d’appartenance et booster la motivation sur la durée. Pour autant, elles doivent être complétées de rituels de communication interne qui viennent jalonner le quotidien à distance, amplifier la fonction d’écoute et accompagner au jour le jour les besoins de chacun.
« Nous sommes attachés aux rituels quotidiens comme se dire bonjour le matin et au revoir en fin de journée sur le chat de l’équipe ».
Des rituels qui, chez Oslandia, peuvent prendre la forme de « pauses café virtuelles » lancées de façon inopinée par un collaborateur via le chat et auxquelles toute personne peut se joindre en fonction de ses disponibilités, comme nombre de salariés ont coutume de le faire autour de la machine à café…
Comme le souligne Jeanne : « Un des risques clairs du télétravail avec forte autonomie et responsabilisation des collaborateurs est le surinvestissement. Nous devons redoubler d’attention, notamment dans les phases de fin de sprint et de fin projet, où la gestion du temps peut être génératrice de stress, a fortiori quand on est seul devant son ordinateur. La fréquence des pauses café virtuelles est à ce titre un excellent indicateur du niveau de pression et de plan de charge de l'équipe ».
Pour appréhender les éventuels problèmes liés à la charge de travail, ou aborder toute question individuelle relative à l’activité, Jeanne anime tous les vendredis matin les « rendez-vous prise de pouls », un dialogue ouvert d’un quart d’heure avec chaque collaborateur. Menés en visioconférence, ces temps de discussion et d’écoute sont essentiels pour interroger les besoins de chacun et apporter du soutien le cas échéant. Sur les volets connaissance de soi et des autres, et communication interpersonnelle, l’entreprise est par ailleurs accompagnée par une psychologue-coach depuis plusieurs années.
Pour que ces temps d’échanges soient fluides et efficaces, et l’organisation optimisée, Oslandia a sélectionné avec exigence les outils de partage et de communication que sont wiki, chat, visioconférence… Des outils essentiels pour le travail en mode collaboratif et précieux au regard de la politique de transparence totale de l’entreprise tant sur l’activité commerciale que sur l’activité de production.
« Chez Oslandia, tout est très documenté, dans une logique de versioning chère à la production du code informatique et qui s’applique à tout type d’échange documentaire. Une activité qui génère en moyenne 50 à 100 notifications par jour ! On doit donc être très attentifs au « signal bruit » et à la charge mentale générée par ce souci de transparence ».
Au terme de cet entretien avec Jeanne Cartillier, deux mots se sont instantanément imposés pour traduire la nature du modèle organisationnel singulier d’Oslandia : « attention » et « humilité ». Une attention aux processus et aux signaux faibles pour contrecarrer et traiter le plus finement possible les défis quotidiens posés par le travail à distance. Et une humilité incarnée par un effort continu pour remettre le travail sur l’ouvrage, afin d’adresser de façon agile les problématiques d’une organisation vivante comme celle d’Oslandia.
La notion d’engagement est dans toute la littérature dès que l’on évoque les enjeux du monde de l’entreprise. Pour autant, votre entreprise vous renvoie-t-elle l’image d’une organisation engagée chaque matin lorsque vous poussez la porte de votre bureau ?
L’engagement, c’est le Graal des organisations. C’est la potion magique qui va permettre aux managers de démultiplier la performance de leur équipe et aux dirigeants d’accélérer la compétitivité de leur entreprise. L’engagement, c’est un sentiment profond d’attachement et de loyauté d’un individu pour son organisation. Un élan qui stimule le travail, non pas strictement pour percevoir un salaire ou pour garder son emploi, mais dans le but d’atteindre, voire de dépasser ses objectifs au sein de l’entreprise. L’engagement nous encourage à dépasser nos limites et à coopérer.
Face aux bouleversements qui affectent l’écosystème de l’entreprise : transformations continues et accélérées, nouvelles aspirations des salariés…, l’engagement est mis à mal. Les organisations sont donc confrontées à un défi de taille pour rester dans la course à la compétitivité : continuer à attirer des talents, engager durablement leurs collaborateurs et les faire monter en compétence. L’entreprise ne doit plus se poser en « consommateur de ressources » mais en « cultivateur de talents ». La performance économique demande désormais beaucoup de créativité, d’esprit critique, de coopération et de communication. Pour émerger, ces compétences ont besoin d’un environnement sain favorisant la confiance à travers la bienveillance, l’autonomie à travers la responsabilisation et l’intelligence collective à travers la coopération. Des compétences également stimulées par une raison d’être puissante agissant comme un exhausteur de talent. Développer l’engagement suppose donc une forte adéquation entre les valeurs de l’entreprise et celles du collaborateur, et une cohérence entre les éléments de sens dont elle est porteuse et leur traduction en actes vécus par les salariés. Et c’est là que la question de l’expérience collaborateur prend tout son sens.
« Comment une organisation peut-elle envisager d’attirer et de fidéliser les talents dont elle a besoin pour se développer si elle ne prend pas soin de l’expérience qu’elle leur fait vivre au quotidien ? »
L’Expérience Client se dresse en étendard de la plupart des entreprises commerciales, et c’est bien normal, puisque sans satisfaction et fidélisation client, pas de croissance sur des marchés de plus en plus concurrentiels… Pourtant, alors que les organisations mobilisent leurs forces vives pour délivrer au client la meilleure expérience possible, elles ont tendance à négliger l’expérience vécue au quotidien par leurs propres collaborateurs.
« Une entreprise, c’est avant tout une histoire d’hommes et de femmes qui vont unir leurs idées, parfois leurs moyens, leurs compétences, leurs savoir-faire, pour atteindre des objectifs communs. Une entreprise, c’est une aventure humaine ». Extrait de l’article [Collaborateur vs Client ? Et si on visait plutôt l’alignement des expériences…]
L’Expérience Collaborateur s’inscrit au carrefour de chaque interaction du collaborateur avec son organisation, avant même son intégration, tout au long de son évolution au sein de l’entreprise, voire même au-delà de son départ. Elle repose sur un principe de cohérence globale, définit par Séverine Loureiro et Myriam Lepetit-Brière dans leur ouvrage « Boostez l’Expérience Collaborateur », autour de cinq leviers d’engagement : le SENS, la mission commune ; l’IMAGE que l’entreprise renvoie et qui concourt au sentiment de fierté et d’appartenance des collaborateurs ; l’ECOSYSTEME qui désigne l’environnement physique, technologique et organisationnel dans lequel les collaborateurs évoluent, l’EPANOUISSEMENT favorisé par l’autonomie et la responsabilisation, alimentés par le développement continu des compétences et la reconnaissance exprimée par le management, et enfin, les CONNEXIONS, à savoir les relations des collaborateurs entre eux, avec l’organisation, avec le management…
La première question que devrait se poser tout dirigeant d’entreprise, notamment en amont de chaque changement de cap, pourrait se résumer ainsi : l’expérience que vivent mes collaborateurs est-elle alignée avec mon organisation et ses enjeux, actuels et futurs ? En bref, les conditions sont-elles réunies pour engager durablement mes équipes et les conduire vers de nouveaux challenges ?
Pour le savoir, pourquoi ne pas leur poser la question ? Evaluer et qualifier l’expérience vécue par les collaborateurs d’une entreprise est une étape déterminante pour identifier les points forts de l’organisation et les axes de progrès sur lesquels mettre le focus. C’est aussi, et avant tout, adopter une posture d’écoute et d’humilité. Les entreprises et leurs dirigeants doivent accepter qu’ils ne détiennent pas toutes les réponses et trouver les moyens d’aller les chercher. L’organisation doit apprendre à écouter, pas seulement ses clients et les marchés, mais aussi ses expertises internes, pour faire évoluer ses orientations dans la bonne direction. Pour ce faire, elle doit passer d’une communication hiérarchique descendante, proche du monologue, à une communication de proximité, de l’ordre du dialogue.
Ce changement de posture dans les organisations s’inscrit dans un nouveau registre de communication, entre écoute et dialogue. Un dialogue ouvert et sincère qui doit prendre sa source au cœur de l’entreprise, sur les questions du travail. Car donner la parole aux collaborateurs pour débattre des règles, des contraintes, des ressources…de leur activité, c’est les reconnaître dans leur autorité sur leur métier et c’est leur donner le pouvoir d’agir au sein de l’organisation. Dans un contexte où le changement est devenu la règle, il faut s’adapter continuellement. Et les solutions ne peuvent s’élaborer que dans un effort commun, par un dialogue permanent pour confronter les objectifs stratégiques avec les réalités opérationnelles. [à lire aussi : Manager, c’est se réapproprier l’essence (les sens) de la communication… et favoriser le dialogue]
Cette communication moins instrumentalisée et plus horizontale vient aussi bouleverser la nature du lien managérial. Car il est essentiel que les organisations reconnaissent le manager dans son rôle de « meneur d’hommes » et le valorisent dans cette mission suprême. Avec comme priorité de remettre le manager de proximité au centre du travail dans un dialogue permanent avec les équipes. Et de faire du manager le « premier média » de l’entreprise, acteur d’une nouvelle communication managériale pour coconstruire le sens, exercer de nouvelles formes de reconnaissance et porter une autorité basée sur l’exemplarité. Un management ramené à ses vertus essentielles : créateur de lien social, révélateur d’intelligence collective, catalyseur de décisions, contribuant simultanément au développement des personnes et de l’organisation. [à lire aussi : Communiquer sur le travail, c’est bien… Communiquer dans le travail, c’est mieux !]
Parce que le manager se trouve à la charnière de contraintes humaines, entre les personnes, le travail et la stratégie, c’est à lui que revient la responsabilité de maintenir l’engagement de ses équipes. Cette nouvelle communication managériale est donc déterminante pour crée les conditions d’un engagement durable dans les entreprises.
Une nouvelle communication qui donne à voir l’entreprise, et qui l’incarne en transparence en réinvestissant le potentiel humain. Une communication qui prend soin de la relation, à l’écoute des besoins des salariés, et qui porte leur voix, comme signe d’appartenance et gage de confiance. Une communication porteuse de valeurs nouvelles pour bâtir un nouveau modèle d’entreprise, en trois dimensions : une entreprise plus incarnée, plus constructive et plus solidaire...
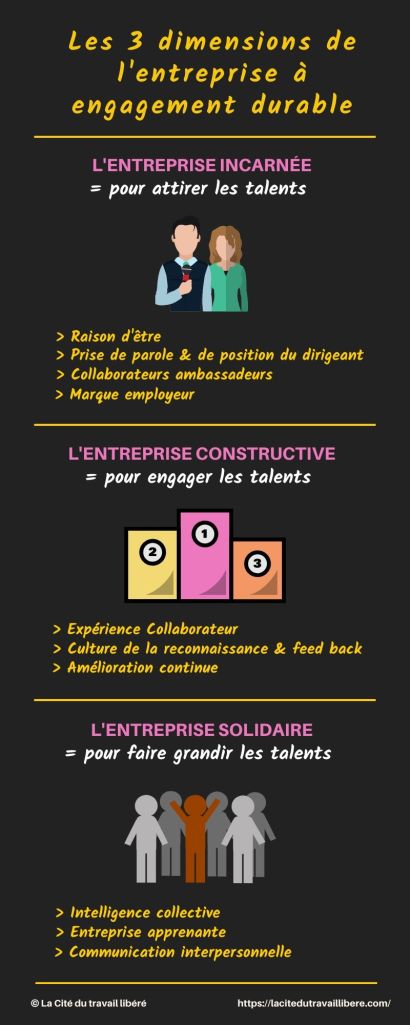

Quand on parle de compétitivité, d’innovation, de numérique, de mondialisation… quels que soient les enjeux, quelle que soit la taille de l’entreprises, le premier défi à relever est celui des talents. Attirer les savoir-faire et les savoir-être qui accompagneront l’organisation dans ses challenges actuels et futurs est un besoin impérieux pour les dirigeants. Mais à l’heure des réseaux sociaux et de la recommandation, la relation employeur/salarié s’est débridée et le rapport de séduction s’est inversé. On n’attire plus aujourd’hui à grand renfort de campagnes hyper-marketées. Il ne suffit plus de scander de beaux slogans pour s’affirmer comme une entreprise où il fait bon travailler… Car aujourd’hui, les candidats sont à l’affût de la réputation des organisations. Et ils ont les moyens de s’informer et de vérifier les gages de popularité des entreprises sur le Net.
Pour être attractive, l’entreprise doit être incarnée. La dimension humaine est déterminante dans sa visibilité car ses valeurs ainsi personnifiées créent un lien affectif, une source d’inspiration et une relation de confiance qui suscitent naturellement l’adhésion, voire l’engagement. Humaniser l’entreprise, c’est lui donner plus de profondeur et de proximité.
Le dirigeant est l’un des principaux visages de l’entreprise. Son rôle est de l’incarner en lui insufflant ses propres valeurs et en prenant la parole de façon régulière sur l’actualité de son entreprise, ses innovations, ses succès, ses distinctions… Son expression est également une excellente opportunité de se démarquer de ses concurrents. Par ailleurs, les réseaux sociaux constituent des médias propices à une certaine liberté de ton pour les entrepreneurs désireux de prendre position sur des sujets moins corporate !
« Sur les réseaux sociaux, les publications de dirigeants reçoivent en moyenne dix fois plus de partages que les contenus de marque. »
Pour conjuguer sincérité et originalité des messages, rien de tel que de donner la parole aux collaborateurs qui sont eux aussi d’excellents ambassadeurs des valeurs de l’entreprise. Valoriser leurs expertises ou leurs réalisations au travers de portraits sur le site carrières, publier des interviews filmées d’experts sur la chaîne YouTube ou le compte Twitter de l’entreprise… Ou encore poster des photos du dernier séminaire d’équipe témoignant de l’atmosphère d’une organisation à laquelle les salariés contribuent tous les jours, sont d’excellents moyens de construire une « marque employeur » efficace. Des contenus qui pourront être partagés spontanément par tous les ambassadeurs de la marque dans un stratégie d’e-advocacy. [à lire aussi : L’Entreprise Incarnée dans toutes ses dimensions]

Le premier réflexe de l’entreprise dans sa course effrénée à la compétitivité, consiste à durcir son niveau d’exigences en interne : toujours plus, toujours plus vite, toujours plus loin… Un réflexe qui met en tension l’ensemble de l’organisation. Pour autant, l’exigence sur le niveau d’exemplarité requis dans le management pour soutenir ces objectifs ne fait que rarement partie du programme... Comment attendre de nos collaborateurs qu’ils soient exemplaires dans leur mission et leurs relations quand leur propre expérience avec leur hiérarchie n’est pas optimale ? Question de bon sens, non ?
Les effets de l’exemplarité sont multiples, notamment sur l'engagement et la volonté de coopérer. Au niveau managérial, Tessa Melkonian, professeur en Management et Comportement Organisationnel à emlyon business school, définit l’exemplarité comme la capacité d’une figure d’autorité, manager comme dirigeant, à mettre en œuvre à son niveau les comportements qu’il/elle déclare attendre du reste de ses salariés. L’exemplarité, c’est montrer à travers ses propres comportements ce qui est attendu et le chemin à suivre. Des comportements qui doivent évidemment être cohérents avec le discours !
A l’heure où les efforts demandés aux salariés sont de plus en plus importants et où les ressources qui leur sont redistribuées fondent comme neige au soleil, l’exemplarité managériale prend une dimension significative car plus que jamais, les collaborateurs observent les comportements de leur hiérarchie et de leurs dirigeants pour déterminer s’ils répondront aux demandes d’adaptation et de coopération de l’organisation ou si, au contraire, ils ne feront que le strict minimum…
Pour être considéré comme digne de confiance par ses collaborateurs, un manager doit donc non seulement faire la preuve de sa compétence professionnelle, mais il doit également démontrer sa capacité à être exemplaire et juste en toute occasion.
« Un salarié qui se sent justement traité déclare être plus confiant, plus satisfait et épanoui, reste plus longtemps dans l’entreprise, a des comportements de citoyenneté organisationnelle, coopère plus avec ses collègues et produit un service de meilleure qualité. » Extrait de l’article [Etes-vous un manager juste ? Ou juste un manager…]
Pour Thierry Nadisic, enseignant-chercheur en comportement organisationnel à emlyon business school, un manager juste est celui qui sait mettre en interaction quatre sentiments de justice :
Ces compétences sont d’autant plus utiles dans les cas de plus en plus courants où les ressources financières sont rares et doivent être partagées. Aujourd’hui, on observe qu’en entreprise, les incitatifs financiers sont minces, voire nuls ou distribués à tour de rôle. A tel point que le système de rémunération, qui était une source de motivation, devient une source de démotivation pour certains, ou une dimension du travail qui ne suscite aucune attente. Pourtant, au-delà des augmentations de salaires ou des primes, il existe d’autres leviers organisationnels pour développer la motivation individuelle et la mobilisation collective
La reconnaissance procure un sentiment puissant et stimulant qui touche aussi bien l’émetteur que le récepteur. Il existe peu d’outils RH ayant un aussi large éventail de retombées positives. Car la reconnaissance :
La notion de reconnaissance est bien plus large qu’on ne peut l’imaginer et au-delà des augmentations de salaires ou des primes, il existe une multitude de pistes pour développer la motivation individuelle et la mobilisation collective. D'ailleurs, une entreprise ne part jamais de zéro en matière de reconnaissance. Il peut donc être intéressant de commencer par identifier les pratiques existantes, puis de les compléter, afin d'établir une véritable culture de la reconnaissance dans l’organisation.
Pour être efficace, la reconnaissance au travail doit donc être partie prenante de la stratégie de l’entreprise et doit être déployée à tous les niveaux. Car elle n’est pas à sens unique, ni réservée à un groupe restreint de personnes que l’on doit motiver alors que d’autres n’en auraient pas besoin. Elle doit concerner tout le monde.
Pour reconnaître ses collaborateurs, il faut les connaître et donc être capable d’identifier leurs attentes personnelles en matière de reconnaissance. Car la reconnaissance s’exprime à travers des relations humaines. C'est pourquoi il est préférable de favoriser l’expression de la reconnaissance en face à face. Pour être authentiques et sonner juste, les gestes de reconnaissance doivent cadrer avec ses propres valeurs. L’impact sera d’autant plus fort, s’ils sont exprimés dans un délai court et s’ils soulignent le plus précisément possible une réalisation, un effort ou un événement particulier.
Les personnes qui font un bon usage de la reconnaissance au travail sont considérées comme possédant des qualités sociales fortes et génèrent un sentiment de confiance, de loyauté et un désir de travailler à leur côté.

Une tâche peut être réalisée seule mais pas un travail. Le travail nous inscrit dans un effort collectif. Cette expérience collective du travail se construit à partir des multiples liens humains qui se tissent, à la fois complexes et fabuleux, quand on prend un peu de recul sur l’ensemble des interactions qui ont favorisé la production d’un produit ou d’un service.
L’expérience collective du travail se traduit par la solidarité. Dans leur effort collectif, les collaborateurs sont solidaires entre eux. Cette solidarité est ce qui donne de la valeur au travail entrepris collectivement. C’est la raison pour laquelle elle doit être valorisée. Car prendre conscience de cette solidarité crée une confiance entre les travailleurs indispensable à la poursuite de leur coopération dans la durée.
« Quand on considère ces écosystèmes qui sont les organisations de travail, quand on mesure leurs impacts psychologiques, on demande que les systèmes soient plus résilients, et pour qu’ils soient plus résilients, il faut qu’ils soient davantage fondés sur la coopération » souligne Bruno Roche, philosophe et directeur du Collège Supérieur dans l’ouvrage L’art de coopérer, manager l’entreprise de demain.
La coopération ne s’impose pas, elle s’invite. Et le premier fondement de la coopération est le partage d’un objectif commun, une œuvre à bâtir ensemble, une aventure à vivre en équipe. Cette œuvre commune donne une finalité que l’on peut célébrer. Une réussite collective dans laquelle chacun se reconnaît, dans laquelle chacun identifie sa contribution, exprime ses talents, développe ses compétences, exerce ses responsabilités… Car dans chaque réussite collective, se dévoile une réussite individuelle.
Cette œuvre commune va renforcer un lien essentiel à la coopération, le lien de confiance. La confiance doit être un prérequis en entreprise. Elle engage et favorise naturellement la coopération entre les collaborateurs dans le sens où elle donne une vision positive et optimiste de l’avenir. La confiance libère le dialogue au sein du collectif et ouvre des perspectives d’innovation et de performance.
Le changement est devenu la règle dans les organisations et il faut s’adapter continuellement. Dans ce contexte, les solutions aux problèmes ne peuvent s’élaborer que dans un effort commun, par le partage de l’information, par un dialogue permanent pour confronter les objectifs stratégiques avec les réalités opérationnelles.
D’où l’importance de mettre en place des démarches facilitant l’expression des salariés comme les Espaces de discussion sur le travail, avec la volonté de renouer le dialogue autour des problématiques liées au travail. Ces espaces collectifs sont des espaces formels et réguliers co-construits avec les parties prenantes de l’organisation. Ils favorisent une culture de la discussion centrée sur l’expérience du travail et ses enjeux, et visent à produire des propositions d’amélioration ou des décisions concrètes sur la façon de travailler.
Dans son ouvrage Le travail à cœur, Yves Clot, psychologue du travail, insiste sur l’importance du collectif pour débattre du travail « bien fait » : « Une communauté de pratiques qui forme un cercle d’échanges dans lequel on s’intéresse moins aux limites de chacun qu’aux limites de l’activité elle-même… ».
Selon l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) les Espaces de discussion constituent de formidables leviers de performance pour les salariés, l’entreprise et le travail.
[à lire aussi : Les Espaces de discussion sur le travail]
Pour transformer en profondeur les pratiques professionnelles, les réponses traditionnelles en termes de formation sont aujourd’hui insuffisantes. Les entreprises doivent immerger leurs talents dans une culture de l’apprentissage en continu et mobiliser leurs ressources dans des situations de travail capacitantes. Elles doivent devenir « apprenantes ».
Née des travaux de Peter Senge, professeur au MIT et fondateur de The Society for Organizational Learning, l’organisation apprenante se définit comme une organisation qui développe sans cesse sa capacité à bâtir son futur.
« Des organisations dont les membres peuvent sans cesse développer leurs capacités à atteindre les résultats qu’ils recherchent, où de nouveaux modes de pensée sont mis au point, où les aspirations collectives ne sont pas freinées, où les gens apprennent en permanence comment apprendre ensemble. »
Développer une organisation apprenante permet d’être plus flexible, efficace, rapide et à la pointe des besoins du marché en mettant les collaborateurs au centre de la réflexion. Ils deviennent ainsi acteurs de l'efficience organisationnelle, et ensemble, ils apprennent de leurs erreurs.
La principale caractéristique de l'entreprise apprenante est que tous les acteurs apprennent les uns des autres. Cette communication transversale permet l'émergence de formes d’innovation, d’intelligence collective ou d’adaptation permanente à l'environnement. C'est ce qui assure le développement durable de l'organisation.
Peter Senge distingue 5 disciplines indispensables aux organisations apprenantes :
L’organisation axée sur l’apprentissage est construite comme un système écologique qui stimule l’apprentissage continu à travers le travail.
L’entreprise n’est pas en dehors de la société, elle est la société ! C’est pourquoi elle a un rôle déterminant à jouer dans l’organisation de la vie au travail. Constituée d’hommes et de femmes animés par des aspirations sociales renouvelées et portés par un élan de « vivre ensemble » inégalé, l’entreprise est responsable de la qualité du lien social qui s’y inscrit.
En invitant ses collaborateurs au dialogue et à l’apprentissage continu au cœur du travail, elle leur donne l’espace pour se confronter à la réalité vivante du travail, et légitimer leur action dans la construction d’un bien commun auquel chacun donne du sens et à l’origine de toute communauté harmonieuse et solidaire. Car aujourd’hui, le sens ne se délivre plus comme une prescription élaborée par une figure d’autorité. La transmission hiérarchisée des valeurs et du sens a cédé la place à l’échange et l’apprentissage entre pairs.
« L’un des principaux enjeux de la Qualité de Vie au Travail se matérialise dans la communication au cœur du travail. » Voilà en substance ce que m’avait répondu une ancienne dirigeante de l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) lorsque je lui avais fait part de mon souhait d’apporter ma contribution au bien-être en entreprise. A l’époque, j’étais au tout début de mon exploration des déterminants de la Qualité de Vie au Travail et je n’ai saisi que plus tard combien le fait que mon parcours dans la communication m’amène sur ce champ d’action n’était pas le fruit du hasard.
Après avoir consacré près de deux ans à m’instruire sur ce vaste sujet, je suis aujourd’hui convaincue que le bien-être en entreprise est une équation à deux variables : le travail et la communication. Pour illustrer mon propos, je ferai référence à deux ouvrages qui me semblent très complets et structurants. A la fois pour comprendre ce qui se joue actuellement dans les entreprises et pour permettre au management d’adopter une posture nouvelle.
Quand j’évoque le travail, je parle de l’activité, du métier dans lequel je mets de moi, le travail dans lequel j’accompli une « œuvre », le travail dans lequel je noue des relations et j’apprends des autres. Ce travail-là, est admirablement dépeint par Pierre-Yves Gomez, professeur à EM Lyon business school, où il dirige l’Institut français de gouvernement des entreprises, dans son ouvrage Le Travail invisible, enquête sur une disparition.
Quant à la communication, elle a aujourd’hui un formidable rôle à jouer au cœur du travail pour redonner du sens et tisser du lien entre les salariés. J’avais l’intime conviction que les entreprises devaient adopter une nouvelle conception de la communication pour attirer et engager leurs talents durablement. Cette conviction a trouvé sa confirmation dans le livre publié récemment par Jean-Marie Charpentier et Jacques Viers, tous deux consultants-formateurs en communication, Communiquer en entreprise, retrouver du sens grâce à la sociologie, la psychologie, l’histoire…
Je vous invite à cheminer entre travail et communication, deux adjuvants à la très actuelle question de l’engagement humain durable, que toutes les entreprises devraient se poser aujourd’hui.
Cette expression empruntée à Pierre-Yves Gomez me semble à elle-seule résumer tout l’enjeu à reconsidérer le travail en entreprise. Son postulat : « Nous devons voir le travail comme la ressource qui donne sens à l’activité économique et sociale et regarder le travailleur dans son effort et dans sa dignité. »
L’auteur fait ici référence au travail réel, le travail que fournissent les hommes et les femmes dans leurs activités quotidiennes. Et pour comprendre la nature du travail réel, il nous propose une représentation en trois dimensions :
Tarir une de ces expériences du travail revient à diminuer l’impact de l’ensemble. Le travail est une épreuve d’humanisation, ou de déshumanisation, selon que l’on en prend soin ou pas.
Et c’est bien là que le bât blesse car avec l’hyper-financiarisation de l’économie ces trente dernières années, le travail est devenu invisible. Invisible sur les radars des gestionnaires qui ne pointent que des résultats et des rendements rangés dans des tableaux… Car en prenant le pouvoir sur les ingénieurs, les techniciens, les commerciaux ou les responsables des ressources humaines, les représentants de la finance ont fait du profit le marqueur principal de ce langage chiffré.
« Il y a financiarisation lorsque la finance n’est plus une ressource pour réaliser les objectifs économiques mais devient l’objectif lui-même. L’atteinte du résultat financier est le but que se donne l’organisation, sa raison d’être ».
Les financiers aux manettes ont ainsi contribué à transformer les organisations en financiarisant le travail lui-même, réduit à des données chiffrées abstraites et globales dans des tableaux de bord. En accélérant les changements de cap et en construisant des stratégies éloignées du fonctionnement pratique des organisations, ils ont produit de la perte de sens et de l’inquiétude.
Selon Pierre-Yves Gomez, le travail a été altéré : « Or il constitue une dimension de l’être humain que l’on ne peut mépriser ou nier sans précipiter l’ensemble de la société dans une névrose inguérissable. Au point de détruire, finalement, même la valeur économique qu’il produit. »
Le travail est le prolongement de soi-même, une activité dans laquelle on se reconnaît. En rendant le travailleur invisible, on appauvrit la nature même du travail. Dans la vie, le travail n’est pas un détail. Il donne à chacun de nous sa place, sa responsabilité et sa dignité dans la fabrication du monde.
« C’est le travail des « vrais » hommes et des « vraies » femmes, leurs efforts, le temps qu’ils y consacrent et leur engagement personnel qui produisent les richesses et les profits. L’économie financiarisée a voulu ignorer ce principe de base : le travail humain est la source de la création de valeur économique. »
L’enjeu désormais consiste donc à construire une société où le travail est de nouveau visible, celui des salariés ordinaires comme celui des managers, des dirigeants... Car le travail est une expérience de vie. Il fabrique de l’humain. Et lorsque nous parlons de notre travail, nous parlons de nous et de la façon dont il nous façonne.
Pour recréer de la valeur économique grâce au travail, Pierre-Yves Gomez nous invite à revisiter chacune des trois expériences qu’il nous fait vivre.
« Le travail ne permet pas uniquement la croissance des capacités personnelles ou l’expression de talents individuels. Il met au monde des produits et des services qui alimentent des communautés. Les objets autorisent des usages et configurent des relations humaines, une façon de vivre ensemble. »
L’expérience subjective du travail est ce que nous mettons de notre individualité dans le travail. Quelle que soit notre fonction, caissière, ouvrier, ingénieur, manager, elle est nuancée par la personnalité avec laquelle nous accomplissons le travail.
Cette expérience subjective crée une valeur économique qui est valorisée par la reconnaissance. Pour bien travailler, le travailleur demande à être considéré, c’est-à-dire être vu pour lui-même, en tant que personne agissante et unique, révélée par le travail accompli. Sans reconnaissance, le travail est anonyme et donc vidé d’une partie de sa réalité, comme s’il avait été accompli par n’importe qui.
Le travail produit quelque chose. A l’issue de l’effort, il y a un objet, un service, qui le matérialise, l’inscrit dans une réalité commune, l’objective donc. Et pour que le fruit du travail puisse être valorisé et ne reste pas dans sa dimension subjective, il doit être apprécié selon des critères d’évaluation partagés.
Cette valorisation de l’expérience objective du travail est plus couramment appelée performance. Quel que soit son contenu concret, la performance exprime toujours l’adéquation entre le résultat du travail et l’objet tel qu’il fallait le réaliser. Rendre la performance manifeste est ce qui fait la valeur du travail.
Une tâche peut être réalisée seule mais pas un travail. Le travail nous inscrit dans un effort collectif. Cette expérience collective du travail se construit à partir des multiples liens humains qui se tissent, à la fois complexes et fabuleux, quand on prend conscience de l’ensemble des interactions qui ont favorisé la production d’un produit ou d’un service.
L’expérience collective du travail se traduit par la solidarité. Dans leur effort collectif, les travailleurs sont solidaires d’autres travailleurs. Cette solidarité est ce qui donne de la valeur au travail entrepris collectivement. C’est la raison pour laquelle elle doit être valorisée. Car prendre conscience de cette solidarité crée une confiance entre les travailleurs indispensable à la poursuite de leur coopération dans la durée. Sans elle, le réseau d’efforts se tarit et le travailleur isolé s’épuise.
Avec la financiarisation de l’économie et la compétition qu’elle a engendré, Pierre-Yves Gomez a constaté une hypertrophie de la dimension objective du travail. Les critères de performance ont pris le dessus sur les autres formes de valorisation du travail réel. Ainsi, l’expérience subjective a été dévalorisée par l’intensification du travail et la normalisation des procédures. Le travailleur n’étant plus perçu en tant que personne au travail mais uniquement au travers de sa production. Parallèlement, la dimension collective du travail a pâti elle aussi des outils techniques de gestion déployés pour intensifier les rythmes, contrôler et évaluer les résultats individuels. Ces outils ont affaibli le sentiment du faire ensemble en introduisant une compétition entre les membres de l’entreprise, les salariés comparant mutuellement leurs efforts et leurs rémunérations pour s’auto-évaluer.
Pour revaloriser cette triple expérience du travail, le rôle du management est aujourd’hui à repenser. Sa place ne se situe pas dans son cockpit à piloter des indicateurs et des données chiffrées abstraites, loin du travail réel. Elle n’est pas davantage sur le dos de ses collaborateurs à contrôler la moindre fraction de leur activité en pointant l’objectif visé. Le management de la performance ne peut être dissocié d’un management humain.
« Il nous faut recruter des managers réconciliés avec leur propre métier […] pour redevenir ce qu’ils n’auraient jamais dû cesser d’être : des meneurs d’hommes. »
Le rôle du manager est littéralement de soigner les expériences subjectives, objectives et collectives que vivent leurs collaborateurs dans le travail réel. Le manager est celui qui permet au travailleur d’exercer sa liberté au cœur du travail ; liberté nécessaire pour que la part normalisée du travail soit acceptable. Elle permet de s’ajuster, de s’adapter quand il le faut et donc d’assumer son engagement personnellement. Elle exprime aussi sa dignité, la capacité d’agir de lui-même, malgré la contrainte de processus complexes. La mission du manager est également de donner du sens au travail de remettre de la cohérence globale dans des tâches éclatées, en pouvant dire à tout travailleur à quoi et à qui son travail est utile, suscitant ainsi le désir de la réaliser. Enfin, le rôle du manager est de savoir, quand il le faut, être fier de ses collaborateurs. En considérant la personne au travail et en la valorisant comme telle, en regardant objectivement sa performance, qui l’engage indépendamment des objectifs et en étant solidaire d’elle dans un travail commun.
« Mais changer les managers ne sera pas suffisant, il faudra aussi que les organisations les accueillent et les valorisent. »
L’entreprise est un organisme vivant qui construit sa valeur économique sur l’expérience vécue du travail réel par ses salariés et les multiples connexions tissées entre ses différentes parties prenantes. Échanger avec un collègue sur un projet, prendre la parole en réunion, conduire son entretien annuel avec son manager… la communication est partout. Et c’est dans la proximité que se joue la plus importante transformation de la communication en entreprise.
Pour bien comprendre quelle place occupe la communication dans les organisations aujourd’hui, Jean-Marie Charpentier et Jacques Viers, nous apportent l’éclairage des sciences sociales. La communication en entreprise hérite en France d’un lourd passé. Pour trois raisons au moins selon le sociologue Philippe Zarifian :
Un triple héritage qui pèse lourdement sur les volontés à ouvrir la communication tant il est ancré dans l’organisation du travail et dans la culture managériale. Pourtant, l’urgence à communiquer n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui dans les entreprises pour répondre à une tendance grandissante à la coopération dans le travail et au besoin de « faire société » face à une altération des liens sociaux et une perte de solidarité.
« Pour être crédible et acceptée, la communication doit faire le pont entre l’opérationnel et le stratégique en mettant à jour, pour les résoudre, les difficultés – voire les conflits – liées à l’activité quotidienne des salariés. La communication se transforme par le bas en quelque sorte. »
Pour accompagner le changement perpétuel qui bouscule les entreprises et les nouvelles aspirations des salariés, la communication doit changer de registre. Elle doit sortir du monologue descendant inspiré de sa fonction de relais d’information et repenser ses moyens d’action. La place du communicant est sur le terrain pour comprendre le travail et interagir avec les équipes et les managers. Il devient activateur de sens et pour cela doit inventer des formes renouvelées de dialogue. Car la construction du sens au travail doit être collective et, surtout, le sens doit pouvoir s’inscrire dans le travail quotidien.
Pour Guy Lochard, chercheur en sciences de l’information et de la communication : « L’important, pour que cela fasse sens, se situe notamment dans l’articulation entre les projets des entreprises et ce que chacun vit comme sujet dans son activité quotidienne. »
Le sens est une affaire de langage et, plus encore, de parole. Échanger sur le sens que chacun met dans son action est le préalable à l’engagement à travers un sens commun.
L’acquisition des talents et l’engagement des salariés font désormais partie des préoccupations centrales des dirigeants ; il importe donc de créer les conditions d’une attractivité et d’un engagement durable dans les entreprises. « Hier, on calculait les gestes. On mesure désormais l’engagement. »
C’est en proximité, au cœur du travail, que les enjeux de communication sont les plus forts dans les organisations, à travers la parole des salariés et les échanges au sein des équipes avec le management. Car si la parole de l’entreprise est en apparence foisonnante et l’information omniprésente, la parole sur le travail au quotidien fait trop souvent défaut.
La communication dans le travail s’articule autour de deux dimensions fondamentales : l’écoute et la discussion. Elles ne vont pas de soi, d’une part parce qu’elles engagent les acteurs et d’autre part parce qu’elles appellent une suite. « On ne parle vraiment que si on est écouté, remarque François Hubault, ergonome. Et on sait bien aujourd’hui en entreprise que si ça ne remonte pas, c’est parce qu’on n’écoute pas ». L’organisation et son management doivent se mettre en situation d’écoute, c’est-à-dire entendre ce qui est dit pour en faire quelque chose.
Le rôle de la communication est ici d’ouvrir un dialogue permanent entre les acteurs de l’entreprise pour confronter les objectifs stratégiques avec les réalités opérationnelles. Ouvrir le débat au sein des équipes sur les différentes façons d’envisager l’activité et partager sur les critères du travail bien fait. En somme, créer des lieux d’expression sur l’activité dédiés à la coopération et permettant à chacun de développer son pouvoir d’agir dans une optique de résolution de problèmes.
Pour coopérer, selon Philippe Zarifian : « …il faut partager la compréhension des problèmes, confronter leur analyse, se projeter ensemble dans l’avenir et anticiper les actions à mener, voire coélaborer, coécrire en quelque sorte la conception de ce que l’on doit entreprendre ensemble. »
Un dialogue permanent avec les équipes qui ne peut s’inscrire que dans un management de proximité centré sur la question du travail.
Dans des organisations souvent hyper-hiérarchisées, le manager de proximité a pris sa place au plus près du terrain. Paradoxalement, en matière de communication, s’il est attendu dans son rôle classique de relais, voire d’interprète des orientations de l’entreprise, il manque trop souvent à l’appel lorsqu’il s’agit d’être en relation avec ses collaborateurs et de tisser du lien au sein de son équipe, en proximité. « Plus la mondialisation gagne du terrain, plus les technologies suppriment les distances, plus on a besoin de retrouver du local et de la relation proche. »
Happés par le pilotage des indicateurs de performance et le suivi des process internes, les managers ont pris de la distance vis-à-vis du travail de leurs collaborateurs. Conséquence directe, ayant une connaissance plus limitée du travail réel de leurs équipes, ils sont moins en confiance pour en parler avec eux.
Cet éloignement managérial produit un triple effondrement : un effondrement du sens, de la reconnaissance et de l’autorité. « Il faut connaître pour reconnaître », résume Mathieu Detchessahar, professeur en sciences de gestion. Si on ne connaît pas le travail, on est dans l’incapacité de le reconnaître, avec les bons mots adressés à « ceux du métier ». Le « bravo » du chef distant, sans autorité, non reconnu, ne vaut rien. Il est considéré comme une manipulation. L’autorité, c’est la reconnaissance d’une parole qui fait avancer, « qui va m’augmenter ». L’autorité augmente la capacité d’action et suscite l’obéissance volontaire. »
C’est donc dans le dialogue, la discussion avec les salariés à propos du travail que se joue l’essentiel de la communication du manager. Pour être crédible au regard des collaborateurs, cette communication managériale se déploie en deux dimensions :
Discuter du travail, c’est bien souvent appeler à sa transformation pour s’adapter à de nouvelles contraintes, de nouvelles tendances du marché… C’est le fait de communiquer qui produit le changement, en confrontant les points de vue, en inventant de nouvelles façons de faire, en co-construisant le changement. « Communiquer dans le travail, c’est se mettre d’accord sur quelque chose à faire en commun et agir avec d’autant plus de force que cet accord est profond. »
Il revient au manager d’organiser le dialogue sur le travail pour produire non seulement des mots, mais des solutions. Cependant, trop souvent, le manager n’est pas investi de ce rôle qui demande un ajustement de l’organisation.
Combien de dirigeants sont prêts aujourd’hui à incarner cette nouvelle communication, plus humaine qu’instrumentale, orientée relations plus qu’outils, soutenue par la proximité plus que par la hiérarchie ?
Combien d’organisations sont prêtes à transformer leur communication au bénéfice d'une véritable culture du dialogue sur le travail ?